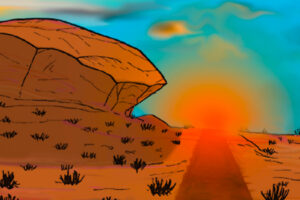Entretien avec Claude Baechtold, réalisateur de Riverboom
« Je suis resté un dilettante »
Rencontre avec le réalisateur de Riverboom, Suisse protestant qui, un jour, est monté dans une voiture avec deux autres protestants. Ça ressemble à une blague, c’est vrai, drôle, et le bonhomme est à la hauteur de son film.
Récit d’un voyage en Afghanistan datant de 2002, sortant aujourd’hui (suite à des cassettes vidéo perdues, puis retrouvées), Riverboom a tout du road movie (lire ici notre dossier) dans un pays où l’espoir renaissait… On connaît la suite, hélas. C’est aussi l’histoire très belle et très joyeuse d’une rencontre et d’une amitié – jamais démentie depuis – entre un journaliste baroudeur aguerri, Serge Michel, un reporter-photographe de guerre émérite, Paolo Woods … et un débutant : le narrateur, Claude Baechtold, jusque-là plutôt sédentaire, maquettiste de métier et photographe spécialisé dans les séries sur un thème unique (les tapis iraniens) et pas très téméraire. Trente ans et orphelin depuis cinq ans à la suite de l’accident de voiture de ses parents au moment des faits, le cinéaste a vingt-deux ans de plus aujourd’hui. Il a fait de ce film un objet unique, singulier, avec voix off désopilante, images accélérées et récits dans le récit (lire ici notre chant d’amour). Un drôle de film rigolo et mélancolique, qui raconte comment, en tombant en panne au milieu de nulle part près d’une rivière en crue, on peut faire le deuil de ses parents, vaincre ses peurs, trouver deux complices pour la vie. Et, finalement, devenir réalisateur. Rencontre avec Claude Baechtold.
Serge m’avait fait acheter une caméra DV au bazar de Kaboul. Moi, je préférais mes photos ! Mes images vidéo, j’avoue, je ne les trouvais pas très belles. D’ailleurs, quand les cassettes ont été perdues par l’ami auquel j’avais confié la tâche de les numériser à mon retour en Suisse, je ne l’ai pas vécu comme une catastrophe. Dans l’intervalle, c’est une histoire que j’ai beaucoup racontée à mes amis, lors des soirées : j’ai toujours su que c’était mon plus beau voyage. Et c’est une histoire que nous nous sommes aussi beaucoup racontée, Serge, Paolo et moi, pour constater d’ailleurs, que nous n’avions pas du tout les mêmes souvenirs.
Je n’étais pas mûr pour réaliser un film à ce moment-là. Si je l’avais monté dans la foulée, il n’aurait jamais ressemblé à ce qu’il est aujourd’hui. En fait, il me restait une cassette dont j’avais fait une copie, et quand, à mon retour d’Afghanistan, la Télévision Suisse Romande m’a demandé des extraits, ils ont choisi les images de violence, celles où on se faisait agresser. J’aurais sûrement monté en ce sens en 2002. En plein dans le mythe du reporter de guerre, parce qu’on ne le déconstruisait pas, alors.
Lorsque j’ai regardé les cassettes, je me suis dit qu’il y avait une histoire. La question était de savoir laquelle et comment. J’ai dit à Serge et Paolo que j’allais raconter MON histoire avec eux, mais que je leur montrerais le travail au fur et à mesure. Moi, je suis très habitué à retrouver du matériel, un peu comme un archéologue qui a prélevé des échantillons et les analyse. Il se dit : « Ah, tiens, une pointe de flèche ! Qu’est-ce qu’on va bien pouvoir en faire ? Qu’est-ce qu’elle raconte comme histoire ? »
C’était un work in progress permanent. Avec mon monteur, Kevin Schlosser, on a tout posé sur la table, on a regardé les sept mille photos et les quarante bandes et on s’est demandé : est-ce qu’on peut raconter cette histoire ? Par exemple, je n’avais pas du tout filmé le départ de Suisse. Fallait-il refilmer, enregistrer Serge qui raconte ? On a fait des essais, c’était très mauvais. Et on a décidé de faire avec ce qu’on avait et, comme dirait Quentin Dupieux, dont je suis un grand fan, dans Nonfilm : « le public comprendra »… Donc on a testé des choses, comme dans un atelier d’expérimentation. Il n’y a pas de règles a priori : si ça marche, ça marche. L’essentiel étant de savoir d’abord si ça marchait sur nous : si ça nous faisait rire et si l’émotion était là. Et après, vous le montrez à des gens qui disent : « On ne comprend rien »… C’est de l’écriture permanente sur du matériau brut qui est, à la base, très sommaire. J’avais réalisé, déjà, un montage accéléré de mes photos pour un festival de court-métrage : ça durait cinq minutes et les sélectionneurs m’ont dit : « Désolés, on n’a jamais réussi à voir votre film, il y a eu un problème technique, on ne parvenait pas à le voir à la vitesse normale ». Bon, je ne leur ai pas dit que ce montage presque stroboscopique C’EST la vitesse « normale » ! Et j’en ai fait le générique de début de Riverboom.
Kevin n’est pas coincé dans des principes. Il ne dit jamais : non, ça ne se fait pas ! Je l’ai parfois entraîné très loin dans cette espèce de magma. En fait, on juxtapose les choses et ensuite on opère des réglages au millimètre. Pour la voix off, je l’écrivais au fur et à mesure, je l’enregistrais sur un petit appareil en me cachant sous ma veste pour étouffer la voix et éviter l’écho. Kevin « posait » sur les images, on regardait ce que ça donnait, il disait : « Là c’est trop long, là on ne comprend pas, là l’intonation n’est pas bonne ». Et on reprenait. C’est pour ça que Kevin Schlosser est crédité au scénario, parce qu’il a largement participé, sur le ton et le contenu. Le problème quand on réalise un long-métrage, c’est de tenir sur la longueur. Une demi-heure, ce n’est jamais difficile, mais je me suis rendu compte à quel point tenir une heure trente était, en tout cas pour moi, quelque chose de difficile ! À la fois « un bonheur et une souffrance », pour citer François Truffaut.
Absolument ! Oui, je revendique ! Je me suis nourri de cinéma toute ma vie, tout en étant photographe, reporter ou journaliste d’investigation. Mais c’est vraiment le cinéma qui me nourrit, c’est ma passion.
Enfant, j’ai vu beaucoup de films à la télévision, il y avait une excellente émission de cinéma avec un film, puis un invité en plateau sur l’unique chaîne en français de la télévision suisse romande… Quand je suis rentré en France, je me suis passionné pour les westerns de Sergio Leone : Il était une fois dans l’Ouest, Le Bon, la Brute et le Truand… Leone, ses personnages qui sont des demi-dieux, des as de la gâchette qui peuvent toucher un clou à 1 km… ça arrache des larmes et cette petite musique (il chantonne)… Mais je me souviens aussi d’avoir trouvé extraordinaire Deux heures moins le quart avant Jésus-Christ (de Jean Yanne, 1982). Il pleuvait quand je suis sorti du cinéma, j’étais en Égypte, j’avais les yeux de Cléopâtre devant les miens. Je devais avoir dix ans, et je trouvais que cette actrice qui jouait Cléopâtre (Mimi Coutelier, NDLR) était formidable. Et Coluche était tellement drôle ! Puis ensuite, à l’adolescence, j’ai découvert Jean Cocteau, sa manière de fabriquer du cinéma comme un magicien, de tourner la caméra, de filmer à l’envers, de peindre des yeux sur les yeux… J’aime beaucoup la part de rêve qu’apportent les cinéastes magiciens comme Georges Méliès ou Cocteau.
Oui, et j’ai une production très éclectique… Et souvent, je me dis : qu’est-ce que j’ai fait de ma vie ? Pas grand-chose ! J’admire les gens qui ont persévéré dans un domaine. Moi, c’est vrai que je suis toujours resté un dilettante. J’ai fait de la photo, du journalisme… Je suis multitâche.
Ils m’ont laissé faire. Ils étaient associés à toutes les étapes, ils ont détesté le premier montage et ils avaient raison. Il y a beaucoup de choses que j’ai découvertes au montage en les mettant bout à bout. Des petits détails qui sont revenus. Par exemple, je me suis toujours moqué de mes deux compagnons en disant que c’étaient des têtes brûlées, et en fait, c’est la seule façon de voyager. Serge disait toujours que plus on est près du danger, plus on arrive à l’évaluer. Et moi, je pensais qu’il fallait être débile pour dire une chose pareille ! Serge a toujours refusé les voitures blindées et les escortes, il n’a jamais voulu faire ses reportages dans le cadre d’un convoi. Il est toujours allé – que ce soit seul ou avec Paolo et moi – au-devant des gens, dans un taxi normal avec un chauffeur et un traducteur normaux… On ne peut pas comprendre ou photographier un sujet si on a peur de lui, parce que sinon, il aura peur aussi. Cette manière de voyager en faisant confiance à des gens qu’on ne connaît pas est finalement assez sûre. Serge et Paolo m’ont beaucoup apporté, beaucoup orienté dans ce voyage. On se demande souvent ce qu’on fait là, ce qu’est notre rôle. Moi, en tout cas, je me pose beaucoup la question par rapport à mes parents : je me dis que j’aurais mieux fait d’être avocat comme mon père et défendre la veuve et l’orphelin… Alors, parfois, je me rassure en me disant : je suis celui qui raconte l’histoire.
J’aime beaucoup citer Nicolas Bouvier, un des auteurs qui m’a appris à voyager. Bouvier dit que la phrase la plus bête qu’il a entendue en Suisse, c’est : « Moi, je ne dois rien à personne, je n’ai pas de dettes » et il dit que lui n’a QUE des dettes. Au moment où j’ai monté le film, je me suis rendu compte à quel point j’avais des dettes envers ce pays. À côté de cette rivière, il s’était bel et bien passé quelque chose, puisqu’on avait pris son nom, Riverboom, pour notre groupe d’édition. Mais, au montage, je me suis rendu compte que c’est là que j’avais vraiment fait le deuil de mes parents. C’est un discours qu’on a beaucoup entendu en Suisse : qu’on était des durs. Mais ce n’est pas du tout le cas, et pas du tout ce que j’avais envie de raconter. Je ne suis pas devenu moins prudent, mais le fait d’avoir peur de tout quand on ne risque jamais rien, ça vient aussi d’un deuil qu’on n’arrive pas à faire, des catastrophes qu’on imagine systématiquement. Je voulais aller au bout de cette honnêteté, raconter ce qui s’était passé. Le passage de la rivière, je l’ai écrit en une nuit, Kevin a monté le lendemain et puis après, je n’y ai plus jamais touché.
Moi, j’ai toujours raconté les histoires de cette façon. En gros, mon premier réflexe depuis toujours, quand je regarde mes images, c’est de fabriquer des familles. Je suis un mélange d’ethnographe et de collectionneur d’opercules de crème à café ! Si on met les photos de barbus ensemble, qu’est-ce que ça raconte ? Lors de mon premier voyage en Iran en 2001, où je suis allé avec Alexandre – l’ami qui m’y a fait rencontrer Serge et qui a ensuite perdu mes cassettes d’Afghanistan ! -, je prenais des photos de tapis et de Peykan (le modèle unique de voiture dans le pays NDLR). C’était la grande époque de Mohammad Khatami, ex-ministre de la Culture et de l’Orientation Islamique devenu président ; l’Iran s’ouvrait à la liberté d’expression et la tolérance, il y avait une légèreté. Et moi, avec mes Peykan, mes voitures toutes identiques en kaléidoscope, je racontais quelque chose de l’Iran. À Téhéran, j’ai rencontré des types qui me disaient : « Moi, quand j’ai du vague à l’âme, je prends un taxi. C’est moins cher qu’un psy, et je fais le tour de la ville en parlant au chauffeur. » Cette voiture a un rôle important dans la vie des Iraniens, et ça participait de cette espèce de gaieté, de mélange joyeux de couleurs.
Oui, il y a un gros avantage, car je l’ai toujours avec moi, et pour rater une photo, il faut vraiment le faire exprès. À l’exception des « too late pictures » (photographies où l’on voit un personnage, un animal ou une voiture sortir du cadre, dont Claude Baechtold se vante d’être le spécialiste dans le film. NDLR), mais ces photos existent parce que j’ai quand même réussi à dégainer mon appareil… même trop tard.
Propos recueillis par Isabelle Danel
Riverboom
En partenariat avec BANDE À PART