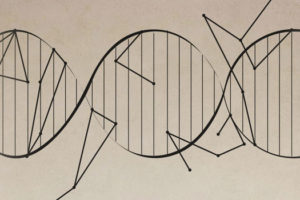Alejandro Landes signe, après Porfirio, son deuxième long-métrage, Monos. En deux films de fiction et un documentaire inédit chez nous, Cocalero (2007), ce presque quadragénaire (en juin !) s’impose comme un auteur à suivre, faisant preuve d’un regard acéré, dérangeant parfois, pour révéler des mondes peuplés d’êtres singuliers.
Né au Brésil, Landes vit désormais à New York, où il s’est installé par amour, précise-t-il ! Il a grandi en Colombie avant de fuir la violence de Medellín dans les années 1990 pour s’installer, avec sa famille, en Équateur. En 2011, il séjourne à Paris dans le cadre de la Cinéfondation, qui lui permet d’écrire Porfirio et de se gaver de cinéma. Monos, multiprogrammé et très souvent primé dans les festivals internationaux, l’a fait voyager de par le monde au cours d’une longue et harassante tournée presse. Celle-ci s’est achevée en France, quelques jours avant la sortie. Enthousiaste, bavard, précis, Alejandro Landes est intarissable et généreux en interview, on jurerait qu’il parle de son film pour la première fois…
Mon scénario est basé sur des témoignages de gens qui ont été kidnappés en Colombie ou ailleurs, célèbres ou inconnus, pour des raisons politiques, de l’argent ou simplement par erreur… J’y ai lu beaucoup de peur et de souffrance, mais aussi des passages qui disaient : « Je suis au milieu de la jungle, c’est ma prison, et c’est le plus bel endroit que j’aie vu de ma vie, en regardant autour de moi, je me dis que Dieu existe… » Beaucoup de ces otages ont raconté que de temps à autre, ils recevaient la visite des chefs, ceux qui commandaient et négociaient. Mais aussi que la plupart du temps, ils étaient en compagnie de leurs gardiens : des sous-fifres, au plus bas de l’échelle dans la hiérarchie de la guérilla, et le plus souvent, des enfants ou des adolescents…
Dans le livre Même le silence a une fin, où Ingrid Betancourt relate ses six années de captivité en Colombie, comme otage des FARC — même si son cas est un peu différent, car elle était une personnalité en vue —, il y a un chapitre où elle raconte qu’à un moment, elle était gardée par des enfants. Tous ces témoignages, que ce soient de petits recueils obscurs tirés à 500 exemplaires ou des best-sellers, m’ont nourri pour écrire. C’est vraiment cette réalité que je souhaitais raconter.
Sa Majesté des mouches et Au cœur des ténèbres sont deux références presque incontournables de la culture littéraire des préadolescents de par le monde. Je les ai lus et ils m’ont marqué, c’est vrai. L’image de la tête de cochon au bout d’une pique, qui vient de Sa Majesté des mouches, je l’ai intégrée à mon film parce que c’est désormais une image aussi signifiante que la boîte de Campbell Soup dessinée par Andy Warhol. Cette image fait partie intégrante de notre pop culture. Il est évident qu’avec Monos, je travaille plusieurs genres, qui vont du film de guerre au fantastique. Beaucoup de choses ont été dites au cinéma, notamment dans Beau Travail de Claire Denis, Requiem pour un massacre de Elem Klimov, Platoon de Oliver Stone, Full Metal Jacket de Stanley Kubrick…
Oui, bien sûr. Et d’ailleurs, celui qu’on appelle le messager dans le film joue son propre rôle. Je l’ai rencontré dans un camp de réinsertion organisé par le gouvernement colombien, où se retrouvent des combattants de gauche comme de droite, qui participent à des thérapies et apprennent des métiers, afin de revenir dans la société. Et j’ai rencontré ce petit bonhomme, qui s’occupait des chevaux dans ce camp. J’ai découvert qu’il était devenu membre de la guérilla à 11 ans, et a grimpé jusqu’au sommet de l’unité combattante, l’une des plus féroces, qui s’appelle Unité de combat 52. Il a déserté à 24 ans, treize ans plus tard. Et cet homme a acquis un savoir gigantesque sur la guerre, il est devenu une sorte de spécialiste. Il m’a donné des tas d’informations et notamment celle-ci : que la guérilla colombienne avait engagé des conseillers de différents horizons pour venir leur enseigner l’art de la guerre, et notamment du Vietnam. Beaucoup de spectateurs et de critiques pensent que la scène où les gardiens se meuvent comme dans un ballet chorégraphié, le corps couvert de peintures, est une figure de style et une référence à Apocalypse Now. C’est en fait une scène que cet homme m’a inspirée.
J’aime ça, j’aime cette sensation. Parfois, dans le film, les personnages brisent le quatrième mur et regardent la caméra. Parfois, c’est du pur documentaire. Le naturel des acteurs se juxtapose avec quelque chose d’artificiel, ce qui crée la surprise. Souvent, le cinéma doit rentrer dans un genre, une case. J’aime le mélange des genres…
C’était un vrai pari de faire ça, par rapport à la façon dont habituellement les films fonctionnent. En général, vous faites reposer le film sur les épaules d’un ou deux protagonistes. Mon histoire est celle d’une mini-société, je les ai appelés « Monos » parce que « mono » vient du grec, qui signifie « un, unique, seul ». Je pense que dans nos vies, en tout cas dans la mienne, la plus grande source de conflits apparaît entre l’individu et le collectif. Surtout à l’adolescence, lorsque que vous voulez être aimé, appartenir à un groupe et, dans le même temps, vous désirez ardemment être vous-même.
Par ailleurs, le film débute sur un sommet, qui est l’une des ressources d’eau principales de la Colombie, et cette eau dévale la montagne jusqu’aux terres basses, pour se jeter dans ces grands rapides, comme on le voit à la fin du film. Mon idée était de filmer Monos comme de l’eau, qui change de direction, donc de point de vue, mais qui change aussi de vitesse, qui perd en route la transparence et la clarté du début … Je voulais éviter le cliché du film de survie façon Rambo et aussi le double cliché du film de kidnapping (je dis « double cliché », car il y a tellement de kidnappings en Colombie), je voulais qu’on se perde dans Monos. Bien ou mal ? Fille ou garçon ? Passé ou futur ? Enfer ou paradis ?
C’était son premier film. J’ai vécu une belle collaboration sur Porfirio avec Thimios Bakatakis, qui a travaillé avec Yorgos Lanthimos sur The Lobster et Mise à mort du cerf sacré. Pour ce film, je cherchais un œil nouveau et je l’ai trouvé. Jasper m’a écrit une lettre après avoir lu le script : celui-ci l’avait beaucoup touché, c’était palpable. Mon coproducteur hollandais m’a conseillé de le rencontrer et j’ai eu immédiatement envie de parier sur son sentiment et son émotion vis-à-vis du film. Le scénario était déjà très découpé techniquement, et storyboardé. Il fallait bien ça, Monos impliquant des enfants, des acteurs débutants, voire des non-acteurs, des acteurs hollywoodiens, des hélicoptères, des séquences sous-marines, des effets visuels, des scènes dans la montagne et dans la jungle…
C’est vrai. Enfin, de ce point de vue, ce qui était compliqué surtout, c’est le fait que ça pouvait changer en un clin d’œil. Littéralement. Vous pouviez vous retrouver dans un nuage, puis soudain en plein soleil, puis tout à coup sous des trombes d’eau… Toute l’équipe pleurait, tombait, paniquait. Mais Jasper était toujours à mes côtés, calme, posé. Personnellement, j’ai pleuré moi aussi ! Je ne voudrais pas entrer dans le cliché d’un tournage façon Coppola ou Herzog, mais je dois avouer que nous avons dépassé les limites de ce qu’un être humain peut endurer, avec son esprit, sa tête, son corps… Parfois, nous étions à 4000 mètres d’altitude, où il n’y a simplement pas d’oxygène ! Vous travaillez par des températures tellement basses et humides que vous pensez que vous allez geler sur place. Et dans la jungle, il y avait cette impression de claustrophobie, qui faisait que vous perdiez sans arrêt la perspective : dans la montagne, au moins, vous pouvez vous mesurer aux sommets, savoir où vous êtes et accepter l’idée d’être un tout petit bonhomme.
Elle a créé un monde fait de mini-références à la rébellion, notamment pour les costumes. Nous avons mélangé les styles : l’uniforme de Boum-Boum est celui des Russes durant la guerre de Crimée, mais sans le drapeau ; Big Foot porte un costume inspiré du mouvement rasta des années soixante-dix ; certains portent des bottes militaires datant de l’invasion américaine en Irak, des accessoires en référence au mouvement mao ou à la guérilla cubaine. Si vous êtes colombien, vous y voyez quelque chose qui se rapproche des FARC, mais avec une étrangeté, et si vous venez d’ailleurs, ça fonctionne aussi, comme quelque chose de réel, mais avec un soupçon de fable.
Grâce à deux femmes exceptionnelles ! L’une, avec laquelle j’avais déjà collaboré sur Porfirio, Lena Esquenazi, Cubaine qui a appris le son en Russie, et la musicienne Mica Levi. L’une ne parle pas anglais, l’autre ne parle pas espagnol. Mica, quand elle a vu Monos, a dit : « J’adore ce film, il faut le laisser tel quel, il n’a pas besoin de musique… » J’ai répondu : « Non, non, non : il faut que l’on y travaille. » Avec Lena, nous avions pris beaucoup de sons naturels, du désert, de différentes montagnes, et nous avons poussé tous ces sons vers quelque chose de particulier. Car ce que vous entendez dans le film n’a rien à voir avec le bruit naturel des lieux : le vent, les ululements, tous ces sons sont réels, mais ils n’existent pas à cet endroit. Pareil avec la jungle : nous avons créé notre propre jungle. On en est venus à la conclusion qu’il fallait une musique minimaliste, en tout cas une musique qui ne réclamait pas un orchestre entier, ce qui aurait été étrange alors que nous parlons d’une petite bande. Et aussi un son qui participe à notre désorientation dans l’espace. Par exemple, il y a des sons très élémentaires, comme souffler dans une bouteille, mais il y a aussi des sons manufacturés, au synthétiseur, qui pourraient provenir d’une scène dans un night-club… C’est une juxtaposition, qui ressemble à celle que nous avons opérée sur les costumes et qui a beaucoup inspiré Mica. Nous avons aussi travaillé le fait d’associer certaines notes musicales à des personnages, comme dans Pierre et le loup… Le mélange des sons de Lena et de la musique de Mica fait que les gens pensent qu’il y a de la musique tout au long du film, et c’est faux… Il n’y a que 22 minutes de musique, ce qui est peu…
C’est la créature de Frankenstein ! Si j’ai un conseil à donner aux autres réalisateurs, c’est : « Ne faites jamais ça… »
Quand on essayait de monter la production et de trouver de l’argent, les gens disaient : « Ouh ! C’est très étonnant ! Mais je ne sais pas ce que c’est ! C’est bien trop risqué, bonne chance…» Donc nous avons de l’argent en provenance de huit pays différents, parce que chaque fois que l’on montrait un peu de ce qu’on avait réussi à tourner, certains nous donnaient une petite somme pour que nous puissions continuer. Je n’ai jamais eu devant moi tout l’argent pour faire ce que je voulais, mais petit à petit on a grappillé à droite à gauche pour faire évoluer le film…
Il faut compter la préproduction. J’ai auditionné 800 adolescents dans toute la Colombie, et parmi eux j’en ai choisi 23, que j’ai emmenés sur les montagnes que l’on voit au début du film. Là, j’ai bâti une sorte de camp de vacances où je les ai entraînés comme des légionnaires, et je les ai regardés porter les armes, danser, etc… Pendant cinq semaines, au terme desquels j’ai gardé les huit acteurs que vous voyez dans Monos. Ensuite, le tournage a duré huit semaines et deux jours, et le montage a duré… très longtemps… J’ai perdu le fil ! Nous étions invités à des festivals, comme Toronto et Venise, mais je ne me sentais pas prêt. J’avais la sensation qu’on regardait encore le film depuis l’autre rive, pas de l’intérieur de la rivière ; c’était beau, mais on restait extérieur… Et pour donner cette sensation d’être immergé, accepter les changement de rythme, les changements de point de vue, il a fallu un certain temps pour que ça fonctionne…
Avec Jean Labadie du Pacte, qui est la première personne et l’une des rares qui a parié sur nous simplement sur scénario, on s’est dit que c’était la bonne combinaison. Nous n’avions pas de distributeurs à l’étranger, seulement en France, et dès que nous avons montré le film, il y a eu un intérêt de la part de presque tous les pays, des USA à l’Australie… Et Monos est un gros succès en Colombie… Ça valait le coup.
En savoir plus : lire notre critique sur Monos d’Alejandro Landes