

Une rétrospective au Forum des images (Home Sweet Home, du 14 décembre au 15 janvier) nous fait pénétrer dans des maisons de cinéma. Visite guidée dans quelques lieux choisis, habités par le cinéma, logeant ses acteurs et ses fantômes.

Maison hantée (pour rire)
Beetlejuice de Tim Burton (1988)
Survolant des arbres et un village, un plan aérien accompagnant le générique de début nous amène sur la maison. Mais par un raccord imperceptible, c’est un bâtiment clairement factice qui nous est donné à voir : sensation renforcée par l’araignée dont les pattes agrippent le toit. La main qui attrape la bestiole sur la maison jouet, centre d’une maquette représentant le bourg qu’on vient de découvrir, la jette par la fenêtre avec vue imprenable sur le village. Dans la maison menacée, il y a un couple, délicieux, amoureux, les Maitland : ils se préparent à passer leurs vacances à bricoler et bichonner leur lieu de vie, tandis qu’une parente responsable d’une agence immobilière locale leur annonce l’offre mirifique venue d’un riche New-Yorkais. Barbara et Adam ne veulent pas vendre. La maison de Beetlejuice ressemble à celle du célèbre tableau de Grant Wood, « American Gothic », et lorsque les Maitland meurent dans un stupide accident de voiture, la photo publiée dans le journal où ils posent devant leur demeure est un rappel évident de cette iconographie symbole d’une certaine Amérique. Ce que raconte le réalisateur aux allures gothiques et aux goût idoines, c’est une histoire de fantômes pour rire, une ode à la différence à travers le personnage de Lydia, l’adolescente (gothique, elle aussi) qui est la seule à voir les sympathiques revenants. Et c’est aussi, mine de rien, un chant d’amour pour une campagne qu’il serait bon de laisser « dans son jus », la famille de riches New-Yorkais s’installant chez les Maitland risquant – si on les laisse faire – transformer la maison en lieu artistique « New Age » et la région en parc d’attraction.
Isabelle Danel

Maison familiale
La Splendeur des Amberson d’Orson Welles (1942 ou sortie France : 1946)
« La Splendeur des Amberson commença en 1873 », dit la voix off du narrateur, Orson Welles lui-même, sur le plan d’ouverture de cette majestueuse demeure aux allures de manoir victorien. La maison est un personnage à part entière, dont la foule envieuse des voisins commente le luxe (60 000 dollars rien que pour le bois, l’eau courante chaude et froide…), autant qu’ils dissertent sur les faits et gestes des propriétaires. Les Amberson sont des aristocrates, au sens littéraire du terme : le Major, patriarche ayant fait fortune, a construit un monde à l’ancienne alors que la révolution industrielle est déjà en marche et que Midland Town est en train de se peupler et s’agrandir pour devenir une « city », une ville. La maison est d’abord montrée de l’extérieur, comme un énorme gâteau trônant dans la rue principale ; nous pénétrons à l’intérieur vingt ans plus tard, lorsque le joyau des Amberson est le théâtre d’un bal merveilleux « qui restera dans toutes les mémoires ». Ce bal est donné en l’honneur du retour du fils unique et prodigue de l’héritière du lieu, Isabelle : George Minafer-Amberson, enfant roi arborant jadis une longue chevelure bouclée et une morgue souveraine, devenu adulte et toujours aussi imbu de lui-même et de son statut de nanti. En plans-séquences, le bal se déploie sous les lustres massifs et les arcades de stuc. L’escalier monumental qui court sur trois étages est la pièce maîtresse de la maison, et le réalisateur l’utilisera comme un paradis que gravissent des jeunes gens, puis comme un lieu de conspiration et enfin, comme le spectre d’une ascension sociale désormais inversée. Lorsqu’à la fin, George et sa tante Fanny, ruinés et littéralement « à terre », se querellent dans la cuisine, un travelling arrière les mène à travers quatre pièces dépouillées de leur faste et dont les meubles épars sont recouverts de draps. La maison a rendu l’âme, ils vont la quitter pour toujours…
Isabelle Danel
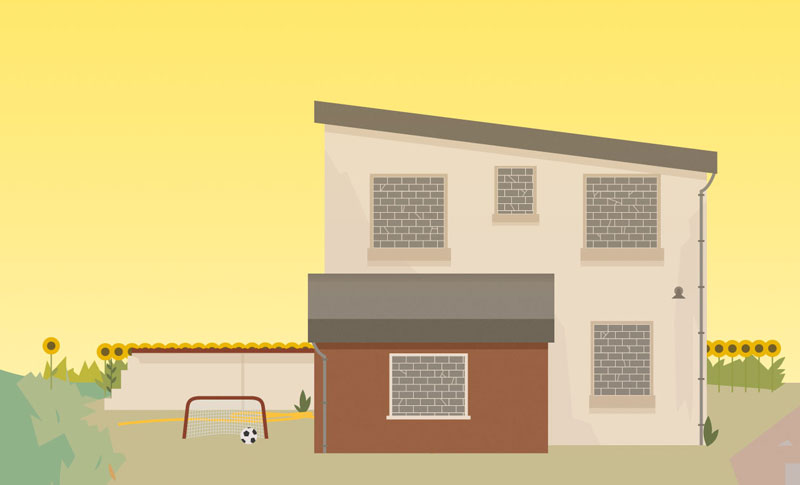
Maison bastion (nous contre le monde entier)
Home de Ursula Meier (2008)
Côté pile, c’est une maison comme les autres, plantée au milieu de nulle part, un champ à perte de vue. Mais côté face, entre la piscine en construction, le transat de la fille aînée qui bronze, et les jouets épars, l’étrange s’invite immédiatement : un ruban d’asphalte, une rambarde partielle où sèchent des chaussures. Les parents, leurs deux filles et leur fils, des gens normaux, joyeux, aimants, vivent au bord d’une autoroute désaffectée, où le benjamin Julien fait du vélo et la famille réunie joue au hockey. Mais des camions orange et des ouvriers débarquent et, sans rien dire, rapatrient sur la pelouse les fauteuils, fermant les rambardes et goudronnant la route… « Cette fois, ils arrivent… », constate le père. Depuis dix ans, ils sont là, ils sont bien, Marthe, la mère ne veut pas déménager – « C’est chez nous, ici »… L’ouverture du nouveau tronçon E57 de l’autoroute annoncé par la radio transforme le pavillon en prison cernée de voitures vrombissantes : impossible de traverser pour aller à l’école ou revenir du boulot, il leur faut désormais ramper dans une bouche d’égout. C’est un film d’horreur qui ne dit jamais son nom ; une invasion inéluctable, visuelle, sonore et toxique. Accompagnée par la peur, sourde, viscérale, puis omniprésente. La cadette compte les voitures et prédit l’empoisonnement au monoxyde de carbone et ses conséquences désastreuses… Car c’est aussi l’étude d’une folie contagieuse : celle d’une mère au foyer qui ne se sent bien que là, dans son cube de béton, derrière la fenêtre de sa cuisine comme devant un écran, puis dans la chambre du fond où tout le monde dort sur les matelas rassemblés à même le sol. Pour elle, les siens décident de rester : avec parpaings et laine de verre, isoler la maison, fermer les fenêtres et cloîtrer la famille dans le silence, loin du fracas du monde. Elle seule peut les sauver de cette prison…
Isabelle Danel

Maison du vertige
Le Mépris de Jean-Luc Godard (1963)
Elle est seule avec la mer. Elle est seule à Capri. La villa Malaparte se tient là, debout, au bout du Capo Massulo, loin des hommes et des routes. Elle défie le vide, en surplomb des falaises tombant dans la Méditerranée. Elle fait balcon sur le golfe de Salerne, défendue par les rochers de Fraglioni, proue fière d’une architecture des années 1930 ébauchée par l’avant-gardisme rationaliste de l’architecte Libera. Curzio Malaparte, l’auteur de Kaputt et La Peau, a rêvé cette maison à son image, une « casa come me », moderne, provocante, vertigineuse. Une maison de pierre sur un pic rocheux, bâtiment trapézoïdal, sur trois niveaux, un toit plat sous le ciel, accessible par un immense escalier pyramidal inversé. Sur l’affiche du 69e Festival de Cannes, solarisé dans un jaune d’or, Michel Piccoli monte les marches comme infinies de ce bunker futuriste, quinze mètres sur huit, aux murs réchauffés d’un rouge pompéien. Il monte les marches de cette villa-œuvre, sur le toit de laquelle Brigitte Bardot bronze nue, un livre sur les fesses, au titre évocateur « Frappez sans entrer… ». La Villa Malaparte se confond avec Le Mépris, que Godard a adapté du livre d’Alberto Moravia : elle seule et hors du commun, seule comme Camille/Bardot et Paul/Piccoli, au bord des gouffres, dans le vertige du désamour, brûlés sous un soleil de plomb quand une froideur sidérante fige leurs liens. Les illusions de la vie comme du cinéma se jouent ici, dans cet éblouissant décor, avec Jack Palance en producteur américain, Fritz Lang dans son propre rôle, tournant L’Odyssée, « l’histoire du type qui voyage » selon Camille. Le cinéma en abyme, un couple qui s’abîme. À la villa Malaparte, un amour s’échoue, voici l’histoire de naufragés, dira Godard, « qui abordent un jour sur une île déserte et mystérieuse, dont le mystère est inexorablement l’absence de mystère, c’est-à-dire la vérité. »
Jo Fishley

Maison futuriste
Mon oncle de Jacques Tati (1958)
Ce n’est pas la maison de M. Tout-le-Monde. La maison proprette, aseptisée et organisée de M. Arpel, son épouse et leur fils Gérard, n’est pas exactement une maison de la vraie vie. La Villa Arpel de Mon oncle paraît avoir été dessinée par la modernité de cartoon de Barbapapas qui auraient rêvé en SF burlesque un habitat futuriste dans lequel logerait une société en pleine mutation. D’un côté les anciens, de l’autre les modernes. La Villa Arpel, en réalité, a été inventée dans la tête de Jacques Lagrange, et montée en décor de cinéma, en 1956, dans les studios de La Victorine, près de Nice. Dans cette maison robotisée, air conditionné partout, cuisine high-tech immaculée, temple des arts ménagers, tout est automatisé, à l’image anticipée de nos intérieurs contemporains connectés. Lignes cubiques épurées et fenêtres hublots, la Villa Arpel dresse son idéal volume avec vue sur un jardin rectiligne rose et bleu, baigné par un bassin d’où jaillit une poisson-fontaine crachant son jet d’eau. Dans le garage, porte automatique que même la queue du chien peut refermer en passant devant la cellule photoélectrique, la Chevrolet Bel Air de Monsieur Arpel est bien rangée. Tout, dans cette maison où l’on s’assoit dans des fauteuils coquetiers, des canapés tubes, loge une vie parfaitement fonctionnelle, une famille devenue elle-même l’objet d’un monde de pure terreur technologique. Madame Arpel fait visiter la maison, symbole de la réussite sociale de son mari, à sa voisine : « Comme vous le voyez, tout communique… » Mais rien ne communique, sinon l’ennui, que trimballe Gérard, dans sa chambre très fonctionnelle. Rien ne communique quand tout communique, et les hommes, tel M. Hulot, l’oncle de Mon oncle, Jacques Tati lui-même, sont perdus et inadaptés dans ce monde qui perd en chemin sa liberté. Dans une maison, il faut toujours pouvoir ouvrir en grand les fenêtres, aspirer de l’air, du grand, à pleins poumons.
Jo Fishley

Maison paranoïaque
The Ghost Writer de Roman Polanski (2010)
Martha’s Vineyard n’est pas une île comme les autres. Sur cette île plate aux côtes frappées par les vagues puissantes de l’Atlantique Nord, au large de Cape Cod, les vents mauvais des saisons hostiles abattent des tempêtes légendaires. Dans ce Massachusetts d’Herman Melville, où les stars et les présidents américains trouvent refuge aux beaux jours, s’acclimate l’atmosphère étrange et inquiétante de The Ghost Writer – et peu importe que tout cela ait été reconstitué ailleurs, en raison de l’impossibilité pour le cinéaste de retourner en Amérique, le récit s’échoue bien ici, en Nouvelle-Angleterre. Dans le huis clos de The Ghost Writer, Roman Polanski installe un nègre (Ewan McGregor) chargé de récrire les mémoires d’un ancien Premier ministre britannique (Pierce Brosnan). Un autre nègre avant lui a été retrouvé mort, mystérieusement échoué. L’écrivain de substitution est enfermé dans une maison coupée du monde, édifice imposant à la minéralité austère, sorte de bunker high-tech sophistiqué, tout en lignes droites et angles rigoureux, les façades percées de larges baies ouvertes sur l’océan tumultueux et le paysage déserté des dunes de Martha’s Vineyard en hiver, sous un ciel de cendres et de pluies. Les plans intérieurs de ce bâtiment de briques et de ciment, à la modernité aussi sévère que luxueuse, organisent des espaces sombres et froids, reliés par des corridors. Aux murs s’accrochent des toiles d’art contemporain aux motifs bizarres. Dans ce lieu isolé, à la solitude menaçante, la maison compose plus qu’un simple décor : elle joue comme un personnage de cette histoire néo-hitchockienne, tout en tensions, troubles et paranoïa. Il y a des mensonges et des secrets entre ces murs.
Jo Fishley
BANDE À PART, partenaire du cycle Home Sweet Home au Forum des images à Paris, du 14 décembre au 15 janvier.































































































































































































