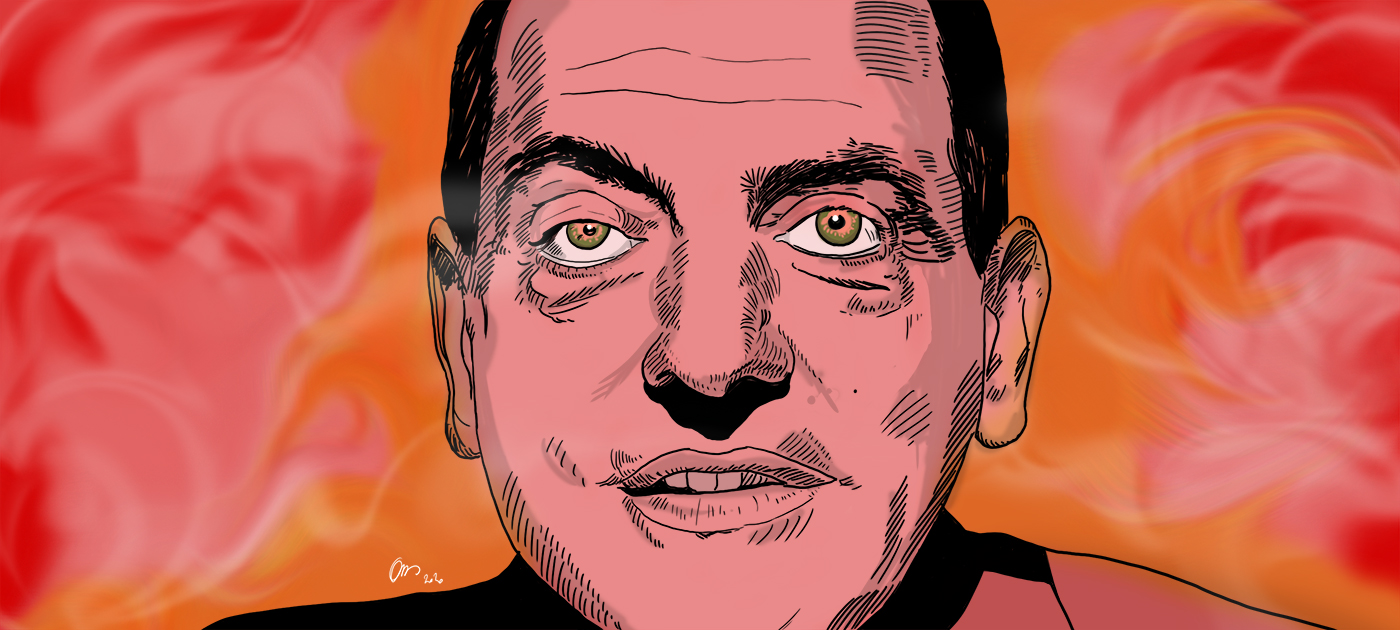Rétrospective Luis Buñuel du 30 septembre au 1er novembre à la Cinémathèque Française. L’occasion pour une partie de l’équipe de BANDE À PART de choisir « son » Buñuel préféré…
Un Chien andalou de Luis Buñuel et Salvador Dali (1929)
Deux grands mouvements d’avant-garde frappent la France à la fin de la Première Guerre mondiale. Né à Zurich en 1916, le dadaïsme se développe chez nous dans les années 1918-19, se dressant contre toute forme de conformisme, dénonçant le patriotisme guerrier et tout ce qui pouvait attenter à la jubilation d’être tout simplement en vie. Le film Entr’acte de René Clair (1924) en est la parfaite illustration. En 1924, déçus par son côté uniquement ludique, de nombreux dadaïstes le dénoncent et se lancent dans l’aventure beaucoup plus radicale du surréalisme. C’est alors qu’à Figueras, Salvador Dali et Luis Buñuel se rencontrent et évoquent, amusés, leurs expériences oniriques les plus mémorables. Le premier a rêvé d’une main parcourue par des fourmis et le second, d’un nuage effilé coupant la lune, ainsi que d’un rasoir tranchant un œil. Grand cinéphile, Dali décida aussitôt d’en faire un film.
Celui-ci vit le jour où, à Paris, Buñuel, alors l’assistant de Jean Epstein, choqua le cinéaste lorsqu’il lui annonça qu’il refusait de travailler avec Abel Gance sur son Napoléon. Epstein le traita alors avec mépris de « surréaliste ». Fort de cette qualification, Buñuel demanda à Dali de l’aider à concevoir un scénario qui, s’appuyant sur leurs rêves du moment, pourrait relever de ce mouvement, qui battait son plein, en 1928, dans la capitale française. Ils s’interdirent tout contrôle de leurs idées par la logique ou la morale, se laissant aller au plaisir de l’écriture automatique, prônée par André Breton et Philippe Soupault dans Les Champs magnétiques (1919). En moins d’une semaine, le scénario fut rédigé. Grâce à l’argent de sa mère et à l’intervention de Pierre Braunberger, Buñuel tourna le film en dix jours au studio de Billancourt au mois de mars 1928. L’apport de Dali, selon le cinéaste (1), se limita à hisser les deux ânes morts sur les pianos dans la séquence de la pulsion sexuelle et à leur mettre du goudron dans les yeux. C’est aussi seul que le futur auteur du Fantôme de la liberté (1974) monta le film dans sa cuisine, à la main, sans aucun équipement technique professionnel. D’une durée initiale de vingt et une minutes, il fut présenté, avec succès, au Studio des Ursulines en juin 1929, les projections se prolongeant pendant huit mois. Faute d’enregistrement sonore, elles étaient accompagnées dans la salle, de manière alternée, par des extraits de Tristan et Isolde de Richard Wagner (Prélude et Mort d’Isolde) et d’un tango argentin.
Un chien andalou, beaucoup plus que L’Âge d’or, le long-métrage du duo, sorti en 1930, est un pur joyau et résume à lui seul l’esprit le plus incandescent du Manifeste du surréalisme d’André Breton (1924). On y trouve, narré de manière non linéaire (le film offre quatre sauts dans le temps), un semblant d’histoire, beaucoup plus mentale que réelle, qui permet aux auteurs de la raconter d’une manière purement onirique. Tout commence par un prologue où Buñuel en personne sectionne, à l’aide d’un rasoir bien affûté par ses soins, l’œil d’une jeune femme (en fait celui d’un veau). Puis, huit ans plus tard, le film nous montre un jeune homme (Pierre Batcheff), soumis à une très forte pulsion sexuelle pour cette même jeune femme (Simone Mareuil), pulsion provoquée par la vue d’un être androgyne (la sculptrice Fano Messan), jouant dans la rue avec une main coupée. Mais ce très fort désir sexuel est vite contrarié par la présence de deux séminaristes, encordés à deux pianos, eux-mêmes recouverts de deux ânes dégoulinant de sang, auxquels est attelé le protagoniste. Seize ans auparavant, celui-ci avait été amené à tuer une personne qui lui avait rapporté ses affaires d’école, qu’il semblait percevoir comme pouvant être son père. De retour au présent, le film montre la jeune femme qui quitte cet intrus libidineux, sort de son appartement pour se retrouver sur une plage où l’attend un futur compagnon. Une histoire qui, certes, défiait alors la raison, mais qui tendait aussi les bras à la psychanalyse freudienne, évoquant les rapports étroits entre Éros et Thanatos, la peur de la castration, le complexe d’Œdipe… des concepts que ne méprisaient pas les Tzara, Aragon et autres Picabia, puisqu’ils représentaient aussi une fort provocatrice manière de douter du… charme peu discret de la bourgeoisie !
Michel Cieutat
(1) Luis Buñuel, Mon dernier soupir, Paris, Laffont, 1982, p.128.
El (1953)
Une église, le jour de Pâques, à Mexico. Détournant le regard du spectacle dérangeant d’un prêtre baisant avec ferveur les pieds nus d’un enfant de chœur, un homme jette son dévolu sur des escarpins noirs avant de remonter le long des jambes galbées et du buste élancé jusqu’au visage. D’ange… L’objet de son attention baisse les yeux sous la mantille de dentelle, les relève et les baisse à nouveau.
C’est un coup de foudre. Ou un coup du sort. Un homme tombe raide amoureux d’une femme. « Mon concept de l’amour est très personnel, expliquera-t-il lors d’un dîner qui scellera leur union : il doit surgir. Un seul regard et vous savez que vous êtes liés pour la vie. » Francisco Galvan, homme pieux et respecté, sait ce qu’il veut et semble toujours l’obtenir. Alors Gloria, pourtant fiancée à un autre, n’y résiste pas.
Mais après une première partie vue à travers les yeux de l’homme, et qui correspond à la conquête, c’est au tour de la femme de raconter la face cachée de cette histoire si romantique et si parfaite. Sa défaite. Et son calvaire, qui a commencé pas plus tard que le soir de la lune de miel. Car, si Francisco dit aimer Gloria « comme un fou », cette expression si banale et si courante est à prendre à la lettre.
Dans un noir et blanc superbe, tout l’univers de Luis Buñuel, passé et à venir, est là : le décorum religieux, le fétichisme, la cruauté, la violence, la souffrance physique et morale. Les mouvements de caméra, très doux, les gros plans sur les visages, le jeu quasi expressionniste des acteurs, tout concourt à faire de El, ce dixième long- métrage – appartenant à la période mexicaine, qui va de Gran Casino (1947) à La Vie criminelle d’Archibald de la Cruz (1955) – un chef-d’œuvre absolu. Pourtant, lors de sa présentation au Festival de Cannes, puis à sa sortie, il fut considéré comme mineur. Trop classique par rapport aux promesses surréalistes des débuts. Il fallut que Jacques Lacan le montre à ses élèves pour qu’on le reconsidère, mais Buñuel a toujours dit de El qu’il était son film préféré.
Adapté d’un roman en partie autobiographique de l’Espagnole Mercedes Pinto, journaliste féministe, qui subit la maladie mentale de son premier époux, s’en sépara et donna ensuite des conférences sur « le divorce comme hygiène de vie », le film est une étude clinique impressionnante de la folie des hommes et de l’emprise subie par les femmes. Et puis, sous une simplicité apparente, que d’élégance et d’invention dans la mise en scène, de l’ombre qui semble fondre sur le visage de Gloria lors de leur premier baiser, à la marche finale hallucinante de Francisco réfugié dans un couvent, en passant par la cloche d’airain faisant résonner les menaces du mari dément en haut du clocher. Pour son art du détail et la montée implacable du drame, le film se redécouvre à chaque vision. Il est inépuisable.
Isabelle Danel
Belle de Jour (1967)
En couple avec Pierre (Jean Sorel), Séverine (Catherine Deneuve), élégante bourgeoise des beaux quartiers de Paris, connaît des fantasmes masochistes empreints de désirs sexuels inassouvis. Un jour, elle découvre en secret une maison de passe, dont elle devient la nouvelle pensionnaire… Belle de jour de Buñuel, qui cumula à sa sortie succès commercial et succès critique, est l’un des sommets de l’œuvre sulfureuse du cinéaste espagnol, marquant d’un sceau inaltérable la carrière de Catherine Deneuve. Cassant l’image romantique des Parapluies de Cherbourg, l’innocente blondeur de l’actrice s’y trouve rouée de coups, maculée de boue, dans une zone indécise entre vierge et putain. Audacieuse pour l’époque, l’actrice garde de son expérience de tournage des souvenirs mitigés, emplis de tensions avec Buñuel, sans regrets néanmoins pour l’ouvrage accompli. Film de producteurs (les frères Hakim), ces derniers ont constitué un obstacle supplémentaire plus ou moins conscient, entre l’actrice, réservée et résistante à trop d’extravagances, et Buñuel, réclamant – malgré une audition en panne -, l’obéissance totale de ses acteurs. Même s’il envisageait un résultat plus cru, plus effronté, Belle de jour n’en constitue pas moins un chef-d’œuvre, coïncidant, selon François Truffaut, « merveilleusement avec la personnalité un peu secrète de Catherine et les rêves du public. Un film formidablement mystérieux, qui lui convenait parfaitement… ». Ciselé encore par des acteurs accomplis dans des rôles secondaires jubilatoires (Michel Piccoli, Geneviève Page, Pierre Clémenti, Françoise Fabian, Macha Méril, Jean Sorel), Belle de jour est un condensé des obsessions essentielles de Luis Buñuel : érotisme, fétichisme, religion, violence, bestialité et cruauté, fantasmes iconoclastes, entre le réel et l’imaginaire, de personnages archétypaux.
Olivier Bombarda
Tristana (1970)
Librement adaptée du roman éponyme de Benito Pérez Galdós, dont le cinéaste mit aussi en images Nazarin et Viridiana, cette coproduction hispano-italo-française permit à Don Luis de retrouver celle qui fut trois ans plus tôt sa Séverine, alias « Belle de jour » : Catherine Deneuve. L’alchimie fonctionna parfaitement, mais cette fois en terre espagnole, dans les rues labyrinthiques et entre les vieilles façades de la ville classée de Tolède. Il est encore question de la fascination érotique d’un homme âgé pour une pure donzelle, comme dans La Jeune Fille, Viridiana et Cet obscur objet du désir. Et comme dans ces deux derniers, le protagoniste masculin a les traits du génial Fernando Rey, oscillant sans cesse entre distinction aristocratique et perversion totale.
Cinquante ans plus tard, le jeu d’attraction/répulsion du duo fascine toujours, sur fond d’Espagne corsetée de 1929, et reconstituée en plein règne franquiste. Le réalisateur faisait alors son retour sur la péninsule ibérique, neuf ans après le scandale de Viridiana. Il y creuse les mêmes obsessions, et y filme ses fétiches féminins. Pieds, chevilles, bas, chaussures, lacets et bottines d’El ou Le Journal d’une femme de chambre trouvent ici leur acmé : l’héroïne-fantasme y finit amputée d’une jambe.
Avec sa chevelure châtain, ses tresses, chapeaux et mantilles, Deneuve passe de l’orpheline ingénue à la femme impériale, jusqu’à offrir en spectacle son corps, sous son peignoir, à un gosse fasciné au pied de son balcon. Entre les deux, la fresque d’un monde où l’hypocrisie de la bourgeoisie, de la religion et des jeux de l’amour triomphe.
La bande-annonce espagnole est un pur délice. Les slogans vocaux s’y enchaînent, avec lenteur et causticité : « Tristana n’est pas un film érotique. Tristana n’est pas un film violent. Tristana n’est pas un film romantique. (…) Tristana, le film le plus espagnol du cinéaste le plus universel. »
Olivier Pélisson
Le Charme discret de la bourgeoisie (1972)
Le titre du film est en soi tout un programme, qui allie à la douce ironie la saveur de la digression. Si charme il y a – et il est bel et bien là ! -, il opère par inversion des codes. Comme chacun peut s’en douter un peu, la discrétion n’a de cesse de se faire remarquer, à l’image de cette bourgeoisie qui aime tant s’écouter, et surtout parler. Aussi tenace que discrète, il faudra un escadron de la mort à lunettes noires pour enfin la faire taire à tout jamais…ou presque !
Ce trentième film de Luis Buñuel commence pourtant fort simplement. Une longue limousine, conduite par un chauffeur en livrée, amène un quatuor élégamment vêtu jusqu’aux abords d’une maison cossue pour un dîner. Mais, ô surprise, la maîtresse de maison ne les attendait guère ; d’ailleurs, son mari n’est même pas présent. Rendez-vous est pris pour le lendemain. Ce premier écart augure de la suite, où le cinéaste va dérouler son théâtre de la cruauté, qu’il distille avec un délicieux sens du comique. Nombreux seront ces dîners et repas inlassablement répétés, souvent inachevés, où toujours l’impromptu surgit, sans queue ni tête, pour le plus grand plaisir des personnages. Mais aussi du spectateur, qui commence à comprendre que le cinéaste n’a que faire de la logique. Le plus curieux, ici, est de constater que seuls les hommes sont travaillés par de sombres rêves, où rôdent des fantômes avec la mort au bout. Ces fantasmes macabres de torture, tant morale que sanglante, s’emboîtent telles des poupées russes, comme si les songes des différents protagonistes de l’histoire ne faisaient qu’un. Les femmes ne rêvent pas, peut-être parce qu’elles ne trempent guère dans le crime, même si elles en jouissent par leurs statuts d’épouses et de maîtresses…
Où s’arrête la fiction et où commence le réel ? Ou bien inversement ? Ni l’un ni l’autre, tant la dialectique et l’opposition n’ont aucun sens dans le monde buñuelien. Tout est affaire de contamination et de résonance, sans logique aucune, si ce n’est, parfois, un sens certain de l’absurde et du comique. Avec, il faut le redire ici, une tendresse pour la vulnérabilité de chacun, même chez le plus ignoble, comme l’ambassadeur du Miranda interprété par Fernando Rey.
Écrit avec Jean-Claude Carrière, le film rassemble de très nombreux acteurs et quelques actrices, et surtout les six personnages principaux interprétés par Bulle Ogier, Delphine Seyrig, Jean Pierre Cassel, Stéphane Audran, Fernando Rey, Paul Frankeur, qui ne cessent de boire et de manger tout en discourant sur leurs mets et boissons. L’inanité comme la vacuité des dialogues participent à l’attraction que le film opère sur nous, un charme faussement ironique, mais si absolument irrévérencieux et, oui, libertaire !
Nadia Meflah
Cet obscur objet du désir (1977)
Pour le dernier film de sa riche filmographie, Luis Buñuel (1900 – 1983) adapte fidèlement le roman de Pierre Louÿs (La Femme et le Pantin) et retrouve pour la quatrième fois son acteur fétiche Fernando Rey. Ce dernier incarne Mathieu Faber, le passager d’un train qui raconte à ses voisins de compartiment ses amours avec Conchita, femme se dérobant sans cesse à ses avances. Son récit commence donc par la parole pour ensuite donner lieu à une mise en images adoptant son point de vue. Nous assistons à sa rencontre avec la femme qu’il désire obsessionnellement, puis à ses déboires, le personnage endurant toute une palette de frustrations et humiliations. Cet homme (qui a pourtant tous les signes extérieurs du dominant social avec son costume parfaitement coupé) voit s’accumuler les refus (notamment celui d’une agence de voyages pour lui remettre ses billets). Et dans la séduction, ce Parisien bourgeois croit maîtriser et dominer sa conquête, une Espagnole pauvre, mais celle-ci ne cesse de fuir ses attentes.
Fidèle à ses thématiques habituelles, le cinéaste inverse les rapports établis pour questionner les représentations et hiérarchies sociales. Dans un café chic, Conchita apparaît comme employée en charge du vestiaire, avant de changer de statut lorsqu’elle s’assoit comme cliente au centre d’une assistance bourgeoise. Il interroge aussi l’incarnation du désir, que l’homme voudrait figer en une image immuable qu’il serait capable de contrôler ; mais, en faisant interpréter son héroïne par deux comédiennes différentes (Carole Bouquet et Angela Molina), il la représente sous une forme versatile, fuyante, imprévisible, qui échappe au regard, tantôt sensuelle et accueillante, tantôt prudente et cérébrale. Avec une piquante ironie, le cinéaste remet en cause le pouvoir social de Mathieu, lequel ne conteste jamais son asservissement : il l’accepte même avec une étonnante docilité. Ce tableau satirique appartient tout entier au surréalisme buñuelien, qui s’amuse à rendre ordinaire la plus grande cruauté.
Face à cette quête de jouissance qui n’aboutit que sur une souffrance, ce pantin assujetti à ses fantasmes, spectateur de ses propres pulsions, fait preuve d’un grand masochisme. Au-delà de ce récit individuel, le cinéaste convoque avec acuité les maux de la société tout entière et apparaît plus que jamais d’actualité dans son questionnement sur la soumission et le consentement. Ces sujets, que le réalisateur espagnol a traités dans tous ses films, trouvent là une radicale et cruelle conclusion. Le dernier plan de ce film, et donc de son œuvre, est celui d’une explosion, mêlant la convoitise aveugle du narrateur à une vaine aspiration.
Benoit Basirico