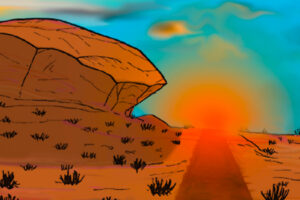

Afghanistan, 2002, début de l’invasion américaine. Trois protestants dépareillés, deux calvinistes suisses et un luthérien hollandais (mais avec un accent italien à couper au couteau, demandez pas pourquoi, c’est déjà assez compliqué comme ça…), montent dans une voiture et commencent à s’engueuler. Qu’est-ce qui pourrait mal tourner ?…
Ça commence comme une blague ? Le fait est que ça y ressemble et que la suite ne va rien arranger ! L’introduction de ce premier film pétaradant donne le la d’une aventure épique, long flash-back de plus de vingt ans relatant deux mois d’un reportage sur le sentier de la guerre, improvisé par trois jeunes hommes à la croisée des chemins : un grand, Serge, leader naturel du groupe, correspondant chevronné au Figaro ; un petit, Paolo, photo reporter volontariste et impatient ; et un moyen, Claude, chômeur bavard encalminé dans le deuil inguérissable de ses deux parents, allongé sur le sol de la vieille guimbarde déglinguée, qui se demande encore comment il a atterri là…
On le devine : à mille lieues de l’exposé géopolitique ronflant, Riverboom se transforme rapidement en roman-photo rigolard, où l’image d’Épinal du grand reporter griffonnant avec une plume trempée dans le sang du monde ses pensées désabusées à la lueur des balles traçantes est remplacée par la course en zigzag de trois loustics lâchés en liberté dans le plus grand champ de mines de la planète… Sur les routes cahoteuses d’Afghanistan, Claude « Pincemi » tire la bourre à Paolo « Pincemoi », sous le regard agacé mais tolérant de Serge, le moine-journaliste aux yeux fixés sur l’horizon et son prochain article. Des Joseph Kessel inconscients, riant comme des enfants pour mieux cacher leur trouille dans cet Orient mystérieux, où il faut savoir user de stratagèmes byzantins pour réussir à faire parler les chefs de village et ne pas vexer les seigneurs de guerre.
Rythmé comme un film de Scorsese, agrémenté de gags visuels dignes de Terry Gilliam, ce documentaire ouvertement comique réinvente le genre du voyage initiatique. Car, sous ses airs de pantalonnade picaresque, sorte de Tour du monde en 80 jours où Passepartout serait devenu un apprenti cameraman incapable de cadrer correctement avec son caméscope acheté dix balles en catastrophe dans un bazar pakistanais avant de sauter dans la voiture par la fenêtre ouverte, Riverboom cache un grand film mélancolique et un récit d’amitié bouleversant. Une évocation rétrospective, deux décennies plus tard, par un chien fou devenu homme, de l’été le plus important de sa vie, où il ne savait pas que trouver sa place à l’arrière d’une bagnole rouillée, avec peu d’espace pour les jambes entre ses deux collègues, lui donnerait avant tout une place dans l’existence.
Mais au fait, pourquoi avoir attendu si longtemps pour organiser cette soirée diapo géante, sur fond de pop italienne et des violons électriques des Rondo Veneziano (kitsch garanti) ? C’est que les chemins d’un film vers un écran sont capricieux : à peine rentré en un seul morceau de cette odyssée intime, Claude confie sa quarantaine de bandes vidéo à un ami avec pour mission de les numériser, ami qui s’empresse de les perdre au bout de quelques jours… Avant de les retrouver au hasard d’un déménagement… vingt ans plus tard… Énormité du destin trop belle pour sembler vraie (et pourtant !), c’est cet ultime clin d’œil qui fait de Riverboom un miracle aussi précieux que réconfortant. Un film qui nous rappelle ce que ce fut d’avoir été jeune, et la chance d’avoir la certitude, comme Claude, d’avoir trouvé la bonne équipe, celle avec laquelle partir au bout du monde.
Emmanuel Raspiengeas































































































































































































