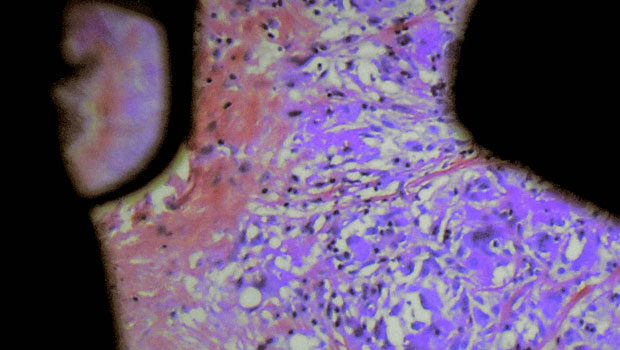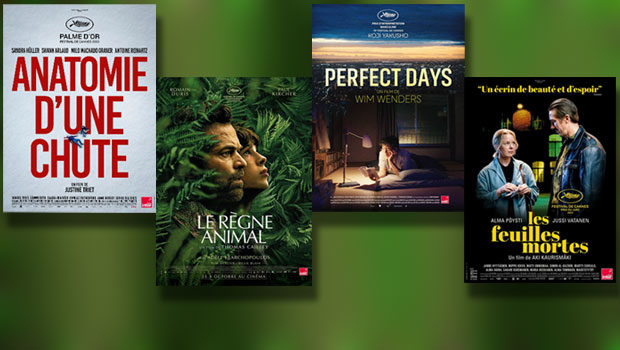Ludovic et Zoran Boukherma changent de registre en adaptant le best-seller de Nicolas Mathieu. Ils s’ouvrent au souffle du récit d’apprentissage et du romanesque en format scope, et livrent une fresque bouleversante.
Ce qui frappe d’emblée à la vue du quatrième long-métrage des jumeaux Boukherma, c’est l’ampleur qu’a gagnée leur cinéma. Pas simplement pour en mettre plein la vue, mais par adéquation avec leur vision, propre à leur désir de mise en scène pour un projet précis, quand Gilles Lellouche a lâché le projet comme réalisateur et évoqué leur nom à ses producteurs Alain Attal et Hugo Selignac. Le choix ambitieux et casse-gueule d’adapter pour le grand écran Leurs enfants après eux, Prix Goncourt 2018 signé Nicolas Mathieu. Le titre est resté le même. Le récit a été ramassé. Les Boukherma ont judicieusement concentré la narration sur les quatre étés successifs qui jalonnent l’intrigue, de 1992 à 1998, sur la seule ville de Heillange, et sur la figure d’Anthony, devenu le vecteur humain central. Les deux autres protagonistes, Stéphanie et Hacine, passent au second plan en représentation, mais restent essentiels. Ce trio juvénile saisit par sa vibration, et par l’incarnation scotchante de Paul Kircher, Angelina Woreth et Sayyid El Alami. Toujours sur l’arête de sentiments exacerbés, mais sans jamais en faire trop, grâce à un savant dosage d’intériorité et de transmission des émotions par les regards, les gestes, les postures.
La puissance romanesque de ces destins enchevêtrés au déterminisme social et à la frustration impressionne. Tous les éléments formels sont tissés pour mieux élever l’histoire au rang d’aventure extra-large. Celle de vies liées à une géographie, une ville du Nord-Est ouvrier et populaire, où les hauts fourneaux se sont arrêtés. Les cinéastes captent avec finesse le désœuvrement d’une population esseulée par la disparition du ciment sociétal et humain. Livrés à eux-mêmes, les êtres s’arc-boutent sur leur individualité et parfois sur leurs rancœurs. Entre pieds et poings liés au terreau d’où l’on vient et rêves inaccessibles (sauf pour Stéphanie). La violence ruminée parfois explose. Sur une nuque, sur une main, sur une mâchoire. L’enchaînement de l’inéluctabilité semble fatale. Et pourtant, d’autres issues sont possibles. L’absence de jugement moral fait un bien fou, quand les représentations fictionnelles appuient parfois sur la binarité. Ici, le désamorçage après les tempêtes saisit et surprend.
En embrassant généreusement le souffle des décors en format scope, en imbriquant thèmes musicaux originaux et tubes anglo-saxons comme français, qui résonnent fort, en mariant gros plans et plans larges, grains de peau et métal, feu et eau, jour et nuit, Ludovic et Zoran Boukherma réussissent brillamment leur baptême de l’air dans la fresque ample. Ils homogénéisent exigence d’auteurs et accessibilité immédiate, après avoir malicieusement visité la radicalité et l’approche du genre pour Willy Ier, Teddy et L’Année du requin. Avec toujours cette véracité du regard sur les réalités sociales, nourri de leur vécu périurbain et de leur sens de l’observation. Une grande maturité dans l’approche du 7e art et de l’art de raconter, ayant digéré modèles et références, pour mieux s’approprier l’héritage du cinéma américain des années 1980 et 1990. Quant à leur travail avec les interprètes, il débouche sur des présences enthousiasmantes, du trio central précité, des parents bouleversants (Gilles Lellouche, Ludivine Sagnier, Lounès Tazaïrt), et d’une nouvelle génération épatante (Louis Memmi, Christine Gautier, Anouk Villemin, Bilel Chegrani).
Olivier Pélisson