
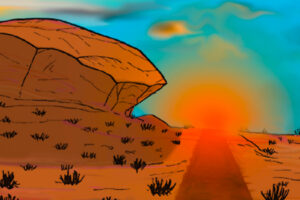
Cinéaste combattant et infatigable, Mohammad Rasoulof ajoute ce nouveau pavé à son chemin. Une fresque humaine nerveuse, en pleine oppression, et plus que jamais d’actualité.
Les Graines du figuier sauvage a fait l’événement sur la Croisette en mai dernier. Tant par sa force intrinsèque que par la présence en chair et en os de Mohammad Rasoulof. Condamné et emprisonné à plusieurs reprises, assigné à résidence, privé de son passeport, interdit de filmer, il a toujours lutté contre l’étau des autorités iraniennes. Jusqu’à quitter clandestinement son pays pour assister au dernier Festival de Cannes, où il était en compétition, avant de s’installer en Allemagne à Hambourg. C’est aussi le cas des trois jeunes actrices de son dernier opus, qui ont rallié Berlin, abandonnant leurs proches et leur terre natale. C’est sa dernière incarcération qui a conduit le cinéaste à écrire ce récit. Le cinquième à sortir sur les écrans français, après La Vie sur l’eau, Au revoir, Un homme intègre et Le diable n’existe pas, tous présentés dans des festivals internationaux majeurs. De l’essence des événements culturels comme espace d’expression et de liberté.
Couvert d’une pluie de récompenses cannoises – Prix spécial du jury de Greta Gerwig, Prix Fipresci de la critique internationale, Prix du jury œcuménique, Prix François-Chalais et Prix des cinémas art et essai -, Les Graines du figuier sauvage est né d’une urgence et d’une nécessité. Celles de raconter l’Iran remis en question par les femmes, suite au mouvement « Femme, vie, liberté », que le réalisateur a pu découvrir pleinement à sa dernière sortie pénitentiaire. La citadelle de l’obscurantisme est fissurée par le dévoilement féminin, et par la prise de parole. Cette sortie en salle arrive à point nommé, alors que les Talibans veulent faire taire les femmes dans une autre nation muselée : l’Afghanistan. Cette épopée de près de trois heures balaie les genres pour mieux confronter un monde à ses contradictions. Chronique familiale, peinture sociale, film politique, suspense, thriller, huis clos et road-movie, l’aventure tient en haleine par son écriture dense et implacable, et par sa poigne de mise en scène.
Mohammad Rasoulof affirme, dénonce, enfonce le clou. Une société qui étouffe court à son implosion. L’oppression est d’autant plus maligne dans la narration qu’elle enserre un père de famille, fraîchement nommé juge d’instruction, dans l’actuelle révolte populaire et féminine. Elle le confronte à ses propres filles, elles-mêmes prises en étau entre l’autorité patriarcale et sociétale, une mère qui veut ménager les deux camps, et un paternel qui tente de ne pas perdre la face. Les donzelles agissent comme elles peuvent, à l’air libre ou en secret, en silence ou cheveux au vent. Interprètes et techniciens ont tout donné pour cette œuvre collective, d’une intensité scotchante, qui n’a rien à envier aux blockbusters. Rasoulof sait faire monter la tension sans jamais perdre ses personnages, ni la flèche qu’il décoche dès le début du long-métrage. Il prend son temps pour gagner en ampleur, de l’enfermement citadin à l’exacerbation en pleine nature. Quand le film s’arrête, on a le souffle coupé.
Olivier Pélisson































































































































































































