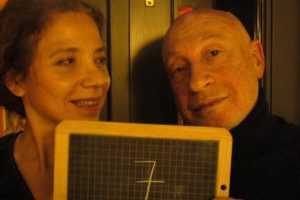Avec Le Tableau volé, Pascal Bonitzer mitonne une aventure subtile et généreuse. Sans grandiloquence rocambolesque, mais avec une précision d’orfèvre, agrémentée d’interprètes finement assemblés.
Savoureuse comédie humaine que le nouvel opus de Pascal Bonitzer. Le réalisateur scénariste continue de croiser les destins, pour raconter une part du monde dans son neuvième long-métrage. Sans coup d’éclat ni esbroufe, c’est un véritable ballet qui s’incarne à l’écran. Par la multiplicité des personnages, des récits et des points de vue. Par la fluidité narrative et formelle, de la caméra de Pierre Milon (seconde collaboration) qui suit les corps dans leur cheminement incessant, au montage de Monica Coleman (quatrième collaboration) qui unifie les pièces du récit. Les intérêts sont divers, mais rassemblés ici par la découverte d’une toile d’Egon Schiele, tenue pour disparue depuis 1939, et de sa grandissime valeur. Tel un palimpseste, le fameux tableau volé par les nazis renaît, mais de lui-même, ressurgi du passé, de la crasse entassée sur sa surface, de la mémoire collective, comme si son histoire se réinventait. Grâce aux regards et aux mots, et à l’aune de son poids commercial.
La trame est inspirée de la véritable réapparition des Tournesols de l’artiste autrichien, dans un appartement en viager de la banlieue de Mulhouse. La maison de vente fictionnelle Scottie’s est une référence à la véridique et prestigieuse Sotheby’s. Le pivot commissaire-priseur se nomme ici André Masson, homonymie du peintre français disparu. Et le titre du film est un clin d’œil au cinéaste Raoul Ruiz et à son Hypothèse du tableau volé, né à l’époque-même où Bonitzer commença à intégrer son univers pour La Vocation suspendue. Mais Le Tableau volé ne se cantonne pas aux hommages et aux citations. Il se tient bien dans le présent. Il raconte le choc des classes et l’instinct salvateur du héros en creux de cette aventure : Martin, jeune ouvrier, sur le regard duquel le métrage se clôt. Une belle création du cinéaste et de son interprète, la révélation Arcadi Radeff.
Sans une once de cynisme, les parcours de vie s’entrelacent, et racontent la revanche sociale, l’amertume, l’audace, la souffrance, le désir, la peur, la joie retrouvée. L’auteur déjoue les écueils que d’autres empruntent régulièrement. L’objet convoité n’est pas dérobé par le copain envieux de Martin. Bertina et Maître Egerman ont plus d’un tour dans leur sac. Aurore fait comme elle peut avec son héritage familial. Et toute la galerie de seconds rôles existe, pour une scène ou deux, ou un seul plan. La petite musique de Bonitzer est particulièrement réussie par sa science des dialogues, de la répartie, du rythme et des contre-temps. Et pour les servir, il a mitonné sa distribution, avec une équipe en grande forme. L’énergie volubile d’Alex Lutz, la précision arythmique de Louise Chevillotte, l’aisance complexe de Léa Drucker, et l’aplomb vibrant de Nora Hamzawi s’accordent parfaitement. Un vrai plaisir.