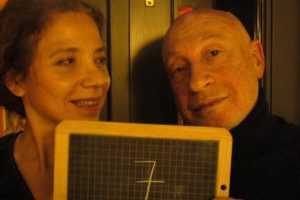En 1815, à Marseille, au début du règne de Louis XVIII et alors que Napoléon s’apprête à quitter l’île d’Elbe, le jeune matelot Edmond Dantès, sur le point d’épouser sa bien-aimée Mercedès, est accusé à tort de menées bonapartistes et emprisonné dans le château d’If. Quatorze années plus tard, il parvient à s’évader et élabore un implacable plan de vengeance.
Le roman d’Alexandre Dumas, coécrit avec son collaborateur attitré Auguste Maquet, fut publié, dans sa version définitive en trois parties, en 1846. À ce jour, il a fait l’objet de vingt-quatre adaptations pour le grand écran, de par le monde, et de douze pour le petit. Parmi les plus célèbres, on peut citer celles d’Henri Fescourt en 1929 avec Jean Angelo dans le rôle-titre, de Robert Vernay en 1954 avec Jean Marais, de Claude Autant-Lara en 1961 avec Louis Jourdan (qui remplaçait Gérard Philipe, décédé) et, pour la télévision, la version de Josée Dayan avec Gérard Depardieu. Il allait de soi qu’après avoir redonné vie, l’année dernière, aux Trois Mousquetaires, l’autre roman d’aventures mythifié de Dumas, Pathé envisageât de récidiver avec Le Comte de Monte-Cristo. Et cela avec la même réussite, à une magnifique différence près.
Contrairement au film de Martin Bourboulon au dynamisme narratif, à la réalisation survitaminée et à l’interprétation pétulante, véritable blockbuster à la française un tant soit peu éloigné de Dumas, celui de Matthieu Delaporte et d’Alexandre de La Patellière (dont le père avait été l’auteur aussi bien d’Un taxi pour Tobrouk en 1960 que de la mini-série… Le Comte de Monte-Cristo avec Jacques Weber !), est non seulement beaucoup plus fidèle au texte d’origine, mais se présente aussi comme relevant, avec une certaine nostalgie, de la tradition du romanesque cinématographique des années cinquante et soixante. Celle des films de cape et d’épée qui faisaient courir les foules, les Capitan (André Hunebelle, 1960) et autres Miracle des loups (id., 1961) avec Jean Marais ou encore les films de Bernard Borderie avec Gérard Barray, comme Les Trois Mousquetaires (1961) ou Le Chevalier de Pardaillan (1962).
En effet, le scénario est à l’image de ceux de cette époque : un ensemble bien dosé de multiples personnages et rebondissements de l’action, rassemblés dans un tout parfaitement rythmé qui nous conduit inexorablement au final, tenant le spectateur en haleine de bout en bout. Ce à quoi s’ajoute un grand nombre de lieux et décors différents, souvent impressionnants par leur flamboyance architecturale (comme l’Hôtel de la Païva et le Palais Brongniart à Paris), ainsi que des extérieurs spectaculaires (certains filmés sur l’île de Malte) imprégnés de couleurs chaudes, dignes de celles des deux grands classiques qu’aiment évoquer Delaporte et La Patellière, Lawrence d’Arabie (David Lean, 1962) et Le Guépard (Luchino Visconti, 1963). Un sentiment d’être cinématographiquement renvoyé dans le temps, entretenu particulièrement par l’interprétation très maîtrisée de Pierre Niney. Devant exprimer une vengeance cruelle, il le fait en affichant un visage toujours impassible, mais dont le regard sombre et tendu laisse cependant percer l’existence d’un volcan intérieur dont il retient l’éruption. Porteur d’une variété de masques qui modifient plus ou moins les traits de son visage, le rendant plus opiniâtre que dissimulé, il affiche, d’autre part, une démarche en parfaite adéquation avec le noir dessein de sa détermination sans faille. Écartant tous les obstacles, il ne s’arrête que pour lancer des regards foudroyants à ceux qu’il rencontre et observe froidement, et par là-même nous glace, face à ce monstre d’immoralité vengeresse. Très certainement la plus grande interprétation d’Edmond Dantès à ce jour, car elle est avant tout ancrée dans une question philosophique intemporelle qu’a judicieusement posée Alexandre Dumas : l’homme n’a jamais cessé d’usurper la place de Dieu pour corriger une quelconque anomalie, confondant vengeance et justice, de la sorte engendrant l’admiration de tous. Une question existentielle, entre autres, que savait soulever le cinéma d’aventures d’autrefois et plus rarement celui d’aujourd’hui. Un rôle en or pour un acteur non seulement talentueux, mais aussi courageux, car il exigea de lui un investissement physique intense dans des domaines nouveaux pour lui, comme l’équitation, l’escrime et la plongée en apnée. Des compliments que nous adressons également à ses partenaires, qui, eux aussi, ont apporté à leurs personnages le juste dosage entre la nécessité de reproduire fidèlement le romanesque propre à la littérature française du XIXe et la manière naturaliste de jouer de nos jours, que ce soit pour exprimer les amours trahies (Anaïs Demoustier), le cynisme (Laurent Lafitte), la traîtrise (Patrick Mille) ou l’aliénation par les fausses valeurs (Bastien Bouillon).
Un film donc fortement imprégné de certains aspects qui faisaient le charme de ces productions d’antan, mais qui présente aussi tous les avantages d’une réalisation moderne, une caméra beaucoup plus mobile qu’autrefois ; une photographie à la palette numérique d’une précision inouïe, mais toujours fonctionnelle (Nicolas Bolduc) ; un rendu des décors extérieurs magistralement mis en valeur par le recours aux drones ; une création très crédible des costumes d’époque (Thierry Delettre) ; un montage percutant (Célia Lafitedupont) qui cerne au plus près les regards très pénétrants des personnages (Niney, Lafitte, Demoustier) ; des sons et bruitages d’un réalisme très travaillé (David Rit), sans omettre une partition musicale (Jérôme Rebotier) au symphonisme hollywoodien modernisé. Un plaisir, donc, vraiment intemporel.
Michel Cieutat