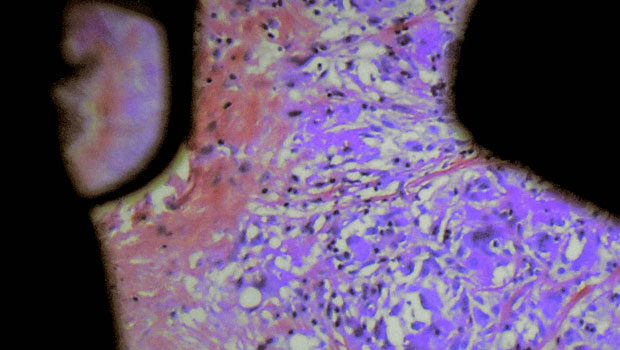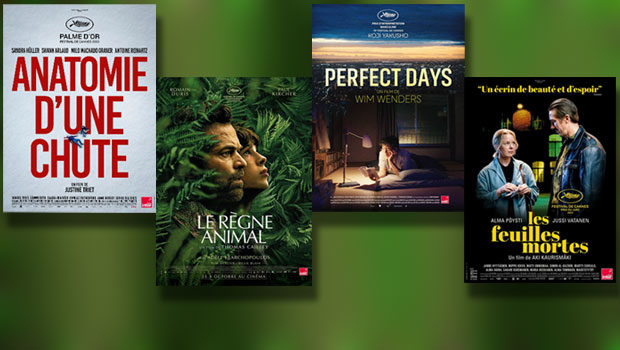Julia Ducournau fait une entrée fracassante dans le long-métrage avec Grave. L’arrivée en école vétérinaire d’une ado surdouée végétarienne, soudain confrontée à la viande crue et à la chair. Toutes les certitudes volent en éclat. Et le talent d’une jeune cinéaste embrase l’écran.
Cannes, Rio de Janeiro, Toronto, Londres, Strasbourg, Sitges, Paris, Sundance, Angers, Gérardmer. Dans tous les festivals où il passe depuis mai dernier, Grave fait l’événement. Pourquoi ? Parce que Julia Ducournau a imaginé une histoire décapante. Fidèle à son idée et à son geste de cinéma. Parce qu’elle va au bout de son imaginaire, sur le fond comme sur la forme. Dix mois après son lancement à la Semaine de la Critique cannoise, où il a reçu le Prix Fipresci de la critique internationale, le film sort enfin dans l’hexagone, et peut rencontrer le public dans les salles.
C’est l’histoire d’une donzelle hyperdouée, qui rejoint à seize ans sa grande sœur à l’école vétérinaire. Il faut dire que tout le monde est véto dans la famille, et que Justine rejoint avec plaisir la meute. Et va s’y fondre encore plus qu’elle n’aurait pu le penser. Quarante ans après Diabolo menthe de Diane Kurys, Ducournau signe elle aussi son premier long, avec le parcours initiatique d’une cadette, témoin des agissements de sa frangine aînée. Mais Justine et Alexia ont des problématiques plus extrêmes qu’Anne et Frédérique dans la France de 1963, et les premières règles d’Anne se mutent ici en un appétit carnivore perturbant, transcendées par les jeunes Garance Marillier et Ella Rumpf.
Tout en digérant les maîtres (David Cronenberg), la cinéaste prolonge ses obsessions, déjà au cœur de son court-métrage Junior, où Garance incarnait aussi Justine, préado, obsédée par son corps et par sa peau. Les réactions de la jeune fille sont dans le long-métrage plus radicales, par la perception et par le rapport à son propre corps, et par extension au corps en général, physique comme social. Passionnant de voir une réalisatrice s’approprier de manière aussi personnelle et affirmée la fiction, le récit, l’écran, avec une audace proportionnelle à la justesse recherchée pour suivre la ligne d’action de son personnage central. Tout comme Marina de Van affrontait la chair, la féminité, la pulsion de vie, le monde, pour Dans ma peau.
Au plus près des visages juvéniles et des corps qui se toisent et s’agressent – bizutage oblige –, la caméra célèbre le mammifère sur deux pattes. Le cadre est net et accompagne avec audace et aplomb l’avancée vers la révélation à elle-même, d’une jeunesse qui ne peut s’assouvir que dans la subversion, loin du chemin collectif tout tracé, d’où toute réflexion est bannie. Les pulsions jaillissent. Justine (salut Sade !) forme un duo jusqu’au-boutiste avec son ami homo (Rabah Naït Oufella au talent confirmé), et passe de végétarienne à cannibale. Les accords musicaux de Jim Williams enveloppent et déstabilisent, au diapason d’une image signée Ruben Impens, à la texture tranchante, aux effets nocturnes hypnotisants, et à une présence dense et vive des couleurs primaires (rouge, bleu, jaune). Séisme garanti.