
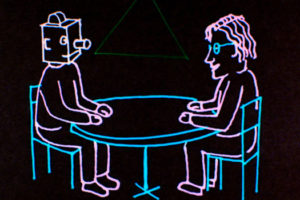
Une retraitée obsédée par les fissures et un gardien d’immeuble accablé allient leurs solitudes et réinventent la gentillesse. Cette comédie dépressive hilarante devrait être remboursée par la Sécu.
Solitude, addiction, dépression, folie, obsession… : la liste des pathologies au programme de Dans la cour est tout sauf revigorante. Et pourtant. Le huitième long-métrage du réalisateur de Cible émouvante (1993) et Les Apprentis (1995) renoue avec le ton bricolé-détaché de ses débuts. Personnages erratiques mais éminemment sympathiques auxquels on s’identifie sans peine : gentils fêlés qui disent un rapport au monde endolori par la somme de toutes nos peurs. Il y a Antoine, chanteur qui ne veut plus chanter, qui aimerait seulement dormir, et traverse la scène de son dernier concert, une valise roulante à sa suite, sans s’arrêter. Antoine se retrouve alors dans une agence pour l’emploi, où une préposée angoissée (Carole Frank) tente de lui trouver de quoi vivre. Vivre, c’est bien la question. Elle lui propose en vrac un boulot de gardien, un peu de Lexomyl, à moins qu’il ne préfère du Lysanxia ? Antoine entre alors en contact avec Mathilde et Serge, un couple de retraités propriétaires d’un appartement au cinquième étage d’un immeuble du nord-est parisien et qui se chargent au nom de la copropriété d’engager le concierge. Serge pense qu’Antoine manque de références et d’expériences en la matière, alors que Mathilde le trouve rassurant, gentil, poli… idéal. Dans la cour est une sorte de tranche de vie (à point), une vision en coupe (déréglée) de la société comme elle va (mal).
On sait gré à Salvadori et son coscénariste d’Après vous… , David Colombo-Léotard, de ne pas avoir joué la carte de l’exhaustivité ou du panel représentatif, mais plutôt d’avoir travaillé en profondeur quelques figures, des hommes et des femmes dont l’excentricité fait d’eux des décentrés, des voyageurs immobiles passant à côté de leur vie, sans jamais masquer leur humanité. De cet aéropage émergent des personnages hauts en couleur : Maillard (Nicolas Bouchaud), le voisin procédurier qui ne supporte pas les transgressions ; Lev (Oleg Kupchik) le vigile flanqué de son chien qui colporte des tracts des Emissaires de la Lumière, censés « muscler l’âme » ; Stéphane (Pio Marmai), l’ex-footballeur, redescendu sur terre après une blessure et qui passe son temps à s’abrutir dans les paradis artificiels… Comme chez Woody Allen, dans les comédies américaines avec Ben Stiller ou Clive Owen, ou dans On connaît la chanson, écrit par Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri pour Alain Resnais, Dans la cour, observe la dépression sous toutes ses formes, dans la joie et la bonne humeur. C’est un film choral qui dissone, digresse et louvoie, pour mieux revenir à ses fondamentaux et observer le rapprochement de deux malades de la vie qui se font du bien mutuellement : Antoine et Mathilde. Ils sont interprétés par Gustave Kervern et Catherine Deneuve, tous deux extraordinaires, si différents et si complémentaires dans la façon de soulever un sourcil ou de balancer un dialogue frappé au coin du non-sens : « La seule chose qui m’apaise m’épuise », « Mon mari est un ex-stalinien, c’est dans leur nature de faire interner les opposants ». Comédie tonique sur la tristesse ou drame mélancolique et joyeux. C’est selon.






























































































































































































