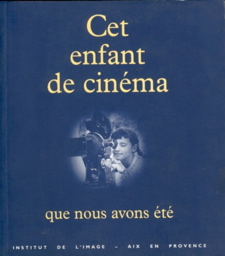Parce que la salle obscure reste le lieu idéal et sacré pour découvrir des œuvres cinématographiques, les BandapArtistes clament leur amour de ces indispensables espaces de vie sociale – à travers des récits d’anecdotes et de souvenirs -, en attendant leur prochaine réouverture.
Me souvenir de ma première salle de cinéma me renvoie à un moment de désarroi intense. Jeune lycéenne, je suivais, depuis plus de deux ans, un programme novateur d’enseignement du cinéma, qui combinait le faire et le dire. Nous étions encore à l’époque de la pellicule et de l’argentique. Notre lycée pilote était généreusement pourvu d’un excellent matériel professionnel, vidéo et laboratoire de photographie compris, mais surtout d’une équipe pédagogique plus que remarquable. Équipe qui a d’ailleurs rédigé, à partir de cette expérience première, un manuel de référence sur cette utopie du cinéma à l’école, La Petite Fabrique de l’image. À cette même période, je fréquentais assidûment deux salles de cinéma, deux mono-écrans qui remplissaient ma mélancolique passion – Le Cyrano à Montgeron et Le Palace à Brunoy. Je réalise, plus de trente ans après, combien je reste attachée à la salle unique, avec son grand écran au fond d’une salle entièrement rouge….
Vivant au cœur d’une cité morose, je devais marcher longtemps avant d’accéder à quelque équipement que ce soit, encore plus à la salle de cinéma, qui n’existait pas dans ma ville. La marche a toujours été inhérente à ma vie. La relative pauvreté dans laquelle vivait ma famille ne nous permettait pas d’avoir une voiture, ce que je n’ai jamais regretté. Au contraire, marcher était déjà, sans que je puisse le comprendre véritablement, un exercice cinématographique, un mouvement du regard et de l’âme qui m’accompagne toujours.
Un aller-retour à pied de mon HLM au Cyrano de Montgeron équivaut à un peu plus de quatre kilomètres. Pour parvenir au cinéma Le Palace de Brunoy, je devais prendre le train à la gare de Montgeron, ce qui me coûtait encore plus d’argent. Or, aller à ce cinéma était une douce obligation, car il était partenaire du lycée de Montgeron pour l’option cinéma. L’argument de l’école annulait dès lors toutes les objections de ma mère, qui ne comprenait pas ma frénésie. Un sou est un sou, le futile n’était pas pensable ni possible. Cette réalité sociale était viscéralement une préoccupation constante. Le plus merveilleux dans cette histoire, c’est de réaliser combien l’école buissonnière qu’offrait le cinéma recevait, par cette option au bac, sa validation légitime à laquelle nul ne pouvait échapper. Aller au cinéma relevait du devoir d’école ! Une incohérence libertaire sublime, qui me ravit aujourd’hui encore…
Un jour où je suis chez ma grande amie de lycée, deux copines nous rejoignent. L’une est la fille d’Alain Bergala, qui coordonnait alors l’ouvrage Cet enfant de cinéma que nous avons été. L’autre était dans ma classe option cinéma. Elles avaient apporté un questionnaire, celui-là même qui se trouve dans ce recueil de souvenirs de différentes personnalités et quelques anonymes, dont cette copine de classe. Elles m’invitent à y participer. Je dois ajouter qu’Alain Bergala était un de nos intervenants au lycée, comme Jean Douchet d’ailleurs, et d’autres tout aussi remarquables. Comme est aiguë la mémoire lorsqu’elle est reliée à des sentiments violents !… Je ne pense pas que ces copines aient pris la mesure de ce qui m’agitait alors. Je n’ai aucun souvenir des paroles que j’ai pu échanger avec elles. En revanche, je me revois lire et relire les questions posées. Cette enquête ne s’adressait absolument pas à moi. Les questions me faisaient physiquement mal. Prise dans une violence symbolique, je me retrouvais perdue, voire plus, désemparée et honteuse. J’entends encore leurs voix : elles se souvenaient de leur enfance, des premières fois ; ce questionnaire fonctionnait comme un sésame romanesque ; elles avaient des anecdotes, des expériences de vie avec leurs parents à partager. Devant tant de questions, mes propres réponses auraient été des blancs ; je n’avais rien à raconter, si ce n’est des silences et des absences. Ces questions s’adressaient à un monde dont je ne faisais pas partie. Mon arrivée dans ce lycée était déjà un arrachement à ma classe sociale, un déclassement par le haut dirait Pierre Bourdieu… Face à ces questions qui me laissaient sans voix, je percevais confusément déjà les blancs de l’Histoire, combien aussi je cherchais dans le cinéma un récit qui me manquait, une mémoire certes fragmentée, mais dans laquelle je pouvais me déployer.
Mais pourquoi la honte, alors ? C’est parce que je n’osais pas dire que ma première séance de cinéma s’était déroulée dans un centre commercial, et non pas à Paris dans une salle Art et essai. Je ne pouvais pas avouer que c’était au cœur d’un complexe que j’avais tant ri face à La Chèvre de Francis Veber. Je ne pouvais pas égrener les beaux noms, encore moins les salles réputées. Le cinéma, je le découvrais quotidiennement à la télévision, sur les chaînes du service public. Lorsque, à vingt ans, je suis partie vivre seule à Paris, je me suis précipitée dans les salles Action – École – Christine, pour enfin voir sur grand écran tous les films que j’avais tant aimés plus jeune sur la petite lucarne.
La honte, et aussi la honte d’avoir honte. Un nœud qui fut souvent agissant sur le plan politique, m’amenant à ne surtout pas rester sur le bord, à refuser d’intérioriser le sentiment d’illégitimité que tout dans la société, et dès l’école, concourait à maintenir. Une honte qui fait encore, hélas, des ravages à plusieurs niveaux. Si je n’avais pas le droit, j’arracherais alors ce droit, différemment, plus difficilement peut-être, mais avec une saveur des savoirs différente.
Je n’avais pour premier souvenir d’une salle de cinéma qu’un endroit bruyant, niché parmi des vitrines et des escalators, un lieu que je n’ai d’ailleurs jamais fréquenté depuis. C’était, je crois, ma sœur aînée qui m’avait entraînée dans une de ses sorties avec ses copines. J’ai le souvenir qu’il faisait froid, était-ce durant les vacances de Noël ? Le film était sorti en décembre 1981, encore deux mois et j’atteignais mes 11 ans…
Lorsque, au printemps 2016, la Cinémathèque française rend hommage à Pierre Richard, j’emmène mon fils, alors âgé de 14 ans, découvrir le film La Chèvre en présence de l’acteur.
Je lui avais raconté l’histoire de cette première séance. Et aussi le fait que cette expérience du cinéma était celle du burlesque, ce qui demeure pour moi d’une logique savoureuse.
Est-ce à dire que la boucle est bouclée ? Je ne pense pas, car elle le fut avant et différemment.
Par exemple, lorsque, invitée par l’Académie de Versailles à l’occasion des dix ans du dispositif Collège au cinéma en Essonne, je me suis retrouvée devant mes professeurs du collège à leur raconter l’Histoire du cinéma. J’étais devenue celle qu’ils devaient écouter, plus de quinze ans après.
Je me suis toujours méfiée des premières fois. Tout se joue, me semble-t-il, avant ou en décalage, dans les interstices et les coulisses. La scène a toujours quelque chose d’obscène et par là-même de sublime. Or, nos mémoires sont des fictions sans cesse retravaillées, seule demeure la souffrance, et parfois l’amour.