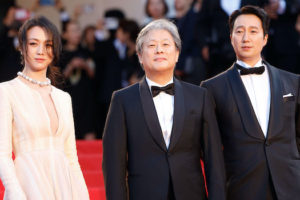Aujourd’hui, le réel nous rattrape et nous gifle. Et l’on se dit que si les films changeaient le monde, l’actualité ne serait pas ce qu’elle est.
Je me souviens d’Elephant de Gus Van Sant, Palme d’or au Festival de Cannes 2003. Film déambulatoire, impressionniste et coloré sur le quotidien d’adolescents dans un lycée de Portland. Des plans- séquences nous embarquent à leur suite dans leurs allées et venues, leurs rencontres, leurs peurs, leurs échanges, leurs liens… jusqu’au moment où deux d’entre eux sortent des armes et tirent… Or aujourd’hui, mercredi 25 mai, on apprend qu’au Texas, un jeune homme a ouvert le feu dans une école primaire. Bilan provisoire : 21 morts, dont 19 enfants.
Je me souviens d’Elephant, qui racontait l’irracontable, et évoquait en écho des tueries qui s’étaient déjà produites, à Columbine ou ailleurs dans ce grand pays, l’Amérique, où le port d’armes est toujours autorisé, voire encouragé dans certains États. Et je voudrais m’en souvenir dans l’absolu parce que c’est un chef-d’œuvre. Et que depuis, personne n’a tiré dans une école ou un lycée, dans un concert ou sur des terrasses. Que depuis, personne n’a foncé en voiture dans un rassemblement ou une foule. Que depuis, personne n’a assassiné un professeur en pleine rue. Et bim, suite de notre série impossible sur les questions sans réponse : Est-ce que le cinéma peut changer le monde ? La preuve que non.
Même le monde ne change pas le monde. Les guerres précédentes n’empêchent pas la guerre en Ukraine. Le réalisateur ukrainien Sergei Loznitsa (très souvent invité à Cannes depuis son premier long-métrage de fiction My Joy (2010) ; récipiendaire du prix FIPRESCI pour Dans la brume (2012) et Prix de la mise en scène à Un Certain Regard avec Donbass (2018) ) a présenté cette année en séance spéciale The Natural History of Destruction. C’est un montage d’archives sur la Deuxième Guerre mondiale, format carré, souvent muet (sans commentaire en tout cas), passant parfois du noir et blanc à la couleur. Terres ravagées, pilonnage incessant, ciel éclaté de bombes, ruines, deuil, exode, visages douloureux, discours militaires. Ce qui n’aurait jamais dû arriver en 1939, encore moins se reproduire. Ce qui, contre toute attente, est en train d’arriver dans le pays d’origine du réalisateur. Aujourd’hui, 25 mai 2022, voici 3 mois et 1 jour que les chars russes sont entrés en Ukraine.
Vive la mort ! Vraiment ? C’était le cri de ralliement des troupes franquistes pendant la guerre d’Espagne. Et c’est avec ce titre iconoclaste et ce film qui ne l’est pas moins, Viva la muerte ! que Fernando Arrabal est revenu au Festival de Cannes hier sur la scène de Cannes Classics. Cinquante et un ans après sa présentation en mai 1971, dans le cadre de la Semaine de la Critique. Copie splendide, restaurée 4K par la Cinémathèque de Toulouse, inondée d’un son impressionnant, Viva la Muerte ! raconte – en flashs, en visions cauchemardesques, en fantasmes, en hallucinations sous psychotropes – l’histoire d’un enfant d’une dizaine d’années, Fando (Mahdi Chaouch) et de sa famille, sous la dictature. Quand la religion, la censure, la violence sont partout. Quand les épouses trahissent les maris, quand une exécution sommaire et monstrueuse dans un cimetière s’achève sur ces mots : « Ils ont tué Federico Garcia Lorca ».
Si l’art, sans changer le monde, fait frémir, bouger, réfléchir, avancer une poignée de gens – et ne serait-ce qu’un seul spectateur -, ce n’est certes pas assez, mais c’est déjà énorme. Les frères Luc et Jean-Pierre Dardenne, deux fois palmés d’or pour Rosetta (1999) et L’Enfant (2005), Prix du Scénario pour Le Silence de Lorna (2008), Grand prix du Jury pour Le Gamin au vélo (2011) sont de retour. Pour la neuvième fois en compétition. Mais ils étaient présents à la Quinzaine des Réalisateurs depuis leur premier film Falsch (présenté à Présence du Cinéma Français, section aujourd’hui fondue dans la Quinzaine) et, surtout, l’inoubliable choc de cinéma que fut le deuxième, La Promesse (1996). Leur douzième film, Tori et Lokita, reprend leur manière, simple, directe de raconter une fuite, une quête, une course, une force de vie. Leur matière, c’est l’humain, contrarié, contrecarré, bafoué, malmené, martyrisé, mais décidé à continuer. Les êtres qu’ils filment tombent s’ils ne courent pas. Alors, ils courent. Ou pédalent à toute blinde comme Tori (Pablo Schils), jeune garçon béninois de 9 ans réfugié en Belgique et qui veut à tout prix rejoindre Lokita (Joely Mbundu), que l’administration, les passeurs, les dealers s’évertuent à éloigner de lui. C’est un film droit et bouleversant, qui montre avec des riens les horreurs traversées par ces deux réfugiés d’Afrique. La façon dont Tori, planqué dans une voiture pour une nouvelle fois aller rejoindre Lokita, ne respire quasiment plus, roulé en boule comme l’invisible qu’on lui demande d’être. Ce plan de quelques secondes nous raconte tout son voyage d’avant, que le film ne montre jamais, évoque comment il a dû se cacher dans des cales de bateau, sous des essieux de camion. Et comment, parce qu’ils ont fait ce voyage ensemble, Lokita et lui doivent rester ensemble. Parce qu’à deux, ils en sont sûrs, ils sont invincibles. Tori et Lokita est un immense film. Et il a été sifflé hier à la projection officielle, un peu, pas beaucoup. Et bon nombre de critiques et journalistes, exploitants, et cinéphiles, festivaliers en somme, trouvent que oui, c’est pas mal, mais bon, les méchants sont très méchants, et puis on a déjà vu ça, non ?
Ah bon ? De cette façon-là, avec ce regard-là, cette simplicité-là ? Cette beauté-là ? Oui, mais non. Simplicité ne signifie par simplisme. Et si l’on aime les auteurs, c’est parce qu’ils creusent le même sillon.