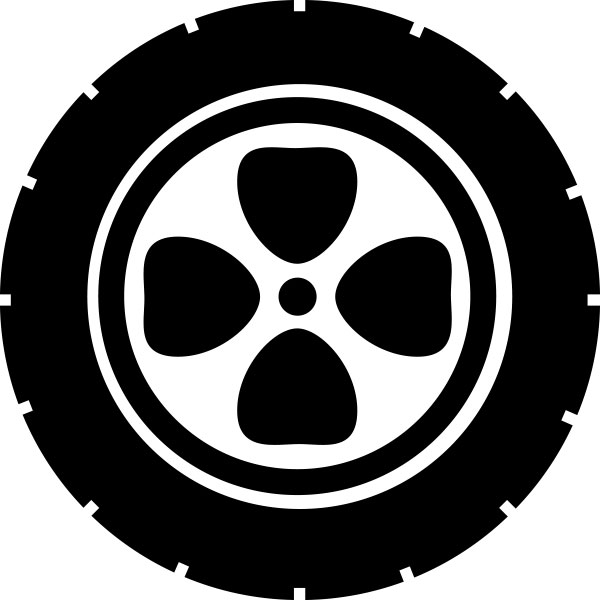En 1986, j’avais 13 ans ; préadolescent timide, j’entretenais un rapport de fascination avec le cinéma, pourtant je n’avais jamais mis les pieds dans une salle obscure. Ma cinéphilie s’était jusqu’alors construite sur le petit écran, souvent celui de mes amis. J’étais alors nourri de films de kung-fu hongkongais, de westerns fordiens, de films d’aventures et de science-fiction turcs. C’est au cours de cette année-là que mon chemin a croisé un univers qui m’était jusque-là inconnu, une esthétique nouvelle, un film.
Tous les ans, je passais mes congés de Pâques chez une cousine lyonnaise. C’étaient des vacances mornes et ennuyeuses. Ma cousine gagnait sa vie comme femme de ménage dans un internat catholique pour jeunes filles et un matin, elle me proposa de l’accompagner. Je découvris un bâtiment en pierre, austère et lumineux. Les chambres des pensionnaires se trouvaient au premier étage, un dédale de pièces que j’entrepris de visiter.
La première chose qui me frappa était l’odeur, celle d’une salle de classe où tous les élèves se seraient aspergés d’un parfum sucré et entêtant. Ce premier assaut olfactif céda peu à peu la place aux traces subtiles laissées par les occupantes des lieux ; je passai de chambre en chambre, troublé par cette expérience olfactive à chaque fois renouvelée. Mon regard s’attarda sur les murs où se déployaient les posters des stars du top 50 : Jean-Jacques Goldman, Madonna, Europe. Sur les bureaux, c’est un petit univers de féminité condensé qui s’étalait, où le stylo plume voisinait avec le rouge à lèvres, les correcteurs avec les vernis à ongles. Je me transformais en explorateur, enquêteur, voyeur. Le mélange des fragrances et les successions de ces univers intimes et féminins me faisaient tourner la tête, me troublaient, j’étais prêt à déclarer forfait, j’avais besoin d’air. Je traversai précipitamment les quelques chambres qui me séparaient de la sortie, me concentrant sur mes pas pour ne pas défaillir, quand une vision m’arrêta net et me coupa le souffle : un homme en cuir, casqué, un fusil à double canon scié dans la main se tenait devant moi, avec en lettres métalliques les mots « Mad Max ». L’affiche couvrait tout le mur au-dessus d’un lit, le reste de la chambre était simple, presque ascétique, comme si l’univers de ce film était si riche, si fort qu’il ne souffrait ni ajout, ni comparaison. C’est à ce moment précis que se mit en marche la machine à fantasmes. Qui était ce mystérieux personnage qui semblait chevaucher une voiture de police ? Que signifiait le mot « interceptor » qu’on pouvait lire sur l’avant du véhicule ? Et quelle était cette étrange prophétie : « Quand la violence s’empare du monde, priez pour qu’il soit là » ? Les jours qui suivirent, je m’imaginais mille histoires où des populations livrées au désespoir étaient sauvées par un messie tout de cuir vêtu, au volant de son fidèle « interceptor ». Il les menait vers un futur meilleur, aidé par des adolescentes en uniforme d’écolière. J’ai fini par voir ce fameux film trois ans plus tard ; je n’ai pas été déçu, son univers si particulier m’a transporté et inspiré et je l’associe depuis aux jeunes filles en fleurs et à cet internat.
La sortie de Mad Max : Fury Road m’a replongé un court instant dans la nostalgie d’une époque où les films ne se livraient pas instantanément, une époque où le contexte de découverte des films et l’histoire qu’on se racontait autour étaient parfois plus passionnants que les films eux-mêmes.