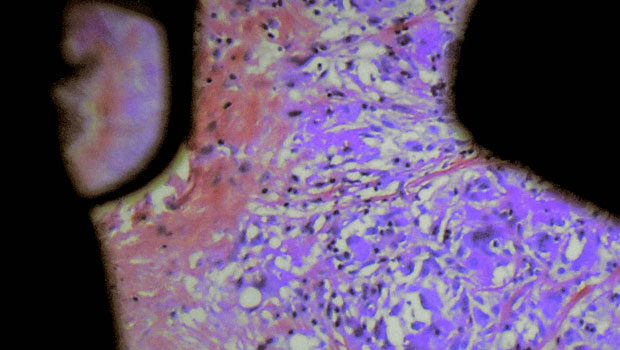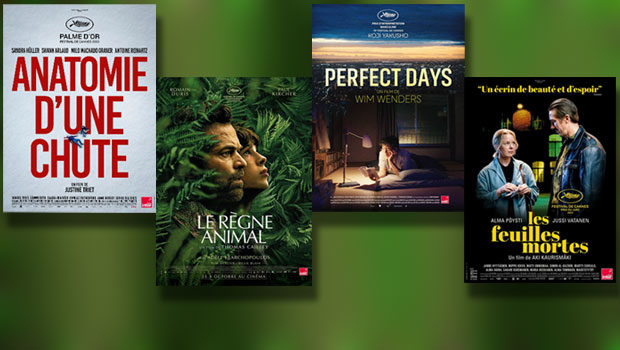Âpre, délicate, profondément émouvante, multirécompensée, Seule la terre de Francis Lee est une œuvre saillante dans le paysage aride des films d’amour entre hommes.
Doublement primé au Festival international du Film de Saint-Jean-de-Luz (prix de la mise en scène et d’interprétation masculine à Josh O’Connor), après avoir empoché une récompense notable au festival de Sundance (mise en scène) et un Teddy Award à Berlin, Seule la terre de Francis Lee ne passe pas inaperçu. Produit par le British Film Institute au même titre que le fut The Young Lady de William Oldroyd, il fait partie de ces films intrépides, dépouillés, d’un abord revêche clairement revendiqué, qui dépoussièrent courageusement le cinéma d’auteur britannique.
Il s’agit du récit d’une rencontre amoureuse – une « histoire simple » certes, mais à mille lieux de l’univers ouaté de Claude Sautet – ayant pour terrain un décor rocailleux, symbole de toutes les difficultés : un amour entre deux hommes naît dans le West Yorkshire, là où seuls les bêlements des moutons viennent briser la monotonie, la tristesse – la quasi-torpeur – du quotidien harassant de paysans perdus entre pluie et brouillard. Dans le cadre de cette réalité campagnarde abrupte (et largement documentée), Johnny (Josh O’Connor), célibataire d’environ 25 ans, vit encore dans la ferme de ses parents âgés, piégé entre la mauvaise humeur d’un père anémié prêt à chanceler et les regards mi-inquiets mi-exaspérés d’une mère qui ne veut rien lâcher. La famille est à la peine, exténuée à la tâche, où il faut continuellement alimenter, soigner ou tondre le bétail, aider les brebis à mettre bas, charrier, nettoyer, récurer, voire construire un mur en pierre dans le froid en plein vent. Johnny en a assez, mais comme beaucoup d’autres, il n’est pas envisageable pour lui de quitter sa famille et sa terre natale. Il entretient d’ailleurs un certain mépris pour les filles à papa, étudiantes et bohèmes, qui passent leurs vacances dans son bled. En réalité, chaque soir, la bière est pour Johnny un refuge, au même titre que le cul de l’un ou l’autre voisin de pub qu’il chevauche à l’emporte-pièce, caché dans les waters. Glauque… Soudain, une lueur apparaît dans sa vie : Gheorghe (Alec Secareanu), un séduisant saisonnier roumain cherchant du boulot, est embauché pour le seconder. Dès lors, naviguant entre cruauté et délicatesse, Seule la terre décolle.
Francis Lee est originaire de la même région sentimentale et géographique que ses personnages. Chaque plan concrétise le bon angle, la bonne température, le bon ton. Son vécu rustique à fleur de peau transparaît. Les errances affectives et les angoisses de Johnny sont bien les siennes, autobiographiques, intimes, éloignées du cœur des villes, les émois d’un rat des champs privé d’amour et de tolérance puisqu’il est entendu qu’ici, seule la terre prime, que le temps dépend de la survie des animaux et que personne ne se consacre à soi-même. Ce constat terrible, point d’orgue d’une solitude archaïque paradoxalement contemporaine, s’oppose tant à l’idée de l’éclosion d’un amour – surtout s’il offusque la bien-pensance – que lorsqu’il naît, il semble irréel. Pourtant, la force de Francis Lee est justement de vouloir le raconter, aussi simplement qu’il s’avère ardent et poignant dans les moindres détails de ce no man’s land de boue et de steppe, contre vents et marées, avec pour ligne de mire la clarté et l’évidence.
Ce geste cinématographique extrêmement positif paraît d’autant plus beau qu’il n’avait pas d’héritier depuis Maurice de James Ivory (1987), une époque où l’on gloussait encore de gêne devant le rapprochement de corps d’hommes à l’écran et qui faisait front à la ribambelle – qui ne se dément toujours pas – d’œuvres catastrophées et morbides sur le sujet. La chose est ainsi suffisamment importante pour être signalée : avec Seule la terre de Francis Lee, le bonheur existe.